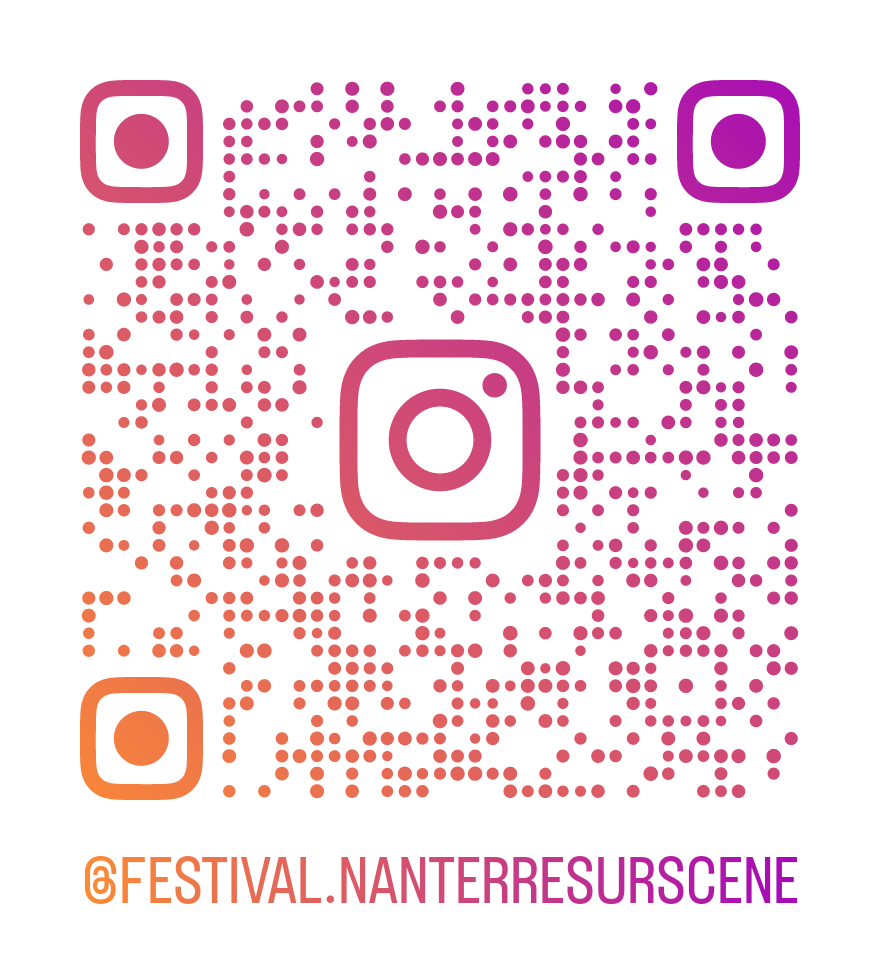Dans la République du bonheur
par la Compagnie Satin Rose
Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3
Date : Mardi 27 novembre 2018
Horaires : 19h30 - 20h45
Lieu : Le chapiteau des Noctambules
Durée : 1h15
Discipline : Théâtre musical

Louise Courtel
Mise en scène : Camille Saintagne
Avec : Daniel Baldauf, Moïra Dalant, Ninon Leyshon, Lise Moreau, Henry Lemaigre, Cécile Oquendo, Pablo Gallego et Louise Cassin
Traduction : Philippe Djian
Composition et musique live : Victor Pitoiset
Costumes : Anna Salles
“Oui, durant des nuits comme celle-ci prendre le taxi est formidable et le fait que je paye pour mon bonheur rend mon bonheur des plus doux – et le fait que d'autres personnes aient à souffrir et travailler pour payer des choses aussi rudimentaires que l'électricité le rend d'autant plus doux. »
Martin CRIMP, Dans la République du bonheur
C’est Noël. Maman, Papa, Grand-mère, Grand-père, Debbie, Hazel dégustent la dinde, baignés par les lumières du sapin artificiel. Les discussions se font tantôt convenues et tantôt acerbes jusqu’à ce qu’apparaisse subitement l’Oncle Bob. Le réveillon familial se transforme bien vite en une satire trash, corrosive et musicale, une réflexion sur le bonheur et la recherche de la perfection dans nos sociétés occidentales. Plongés dans une dramaturgie déstructurée qui emprunte ses trois parties à la Divine Comédie (l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis), nous sommes confrontés aux vices de ces personnages. Au travers de l’écriture acérée et implacable de Crimp, le microcosme de la bulle familiale devient le miroir de la société : ses névroses, ses obsessions, sa violence.
« Les 8 comédiens [et le musicien en live] transmettent un enthousiasme contagieux. Trouveraient-ils dans cette pièce matière à règlements de comptes ? Comme une occasion à ne pas manquer ? Ils nous emmènent avec eux dans ce tourbillon d’horreur joyeuse, de terreur des repas de Noël, de faux-semblants à s’en faire péter la dernière opération de chirurgie esthétique. »
Théâtrorama
Entretien
Votre spectacle reprend le texte de Dans la République du Bonheur de Crimp, qu’est-ce qui vous a attiré dans cette pièce ?
Camille : L’attirance pour ce texte au départ vient majoritairement d’un choix personnel. C’est un texte que j’avais découvert à Montréal. Quand j’étais au Québec (qui est un peu une petite “république du bonheur” pour la France), j’ai commencé à me rendre compte qu’il y avait plein de problèmes politiques dont on n’avait pas trop conscience depuis la France. En plus de ça, on était plongé dans l’état d’urgence en parallèle. Du coup, la question de la place de l’État dans la vie privée se posait. Le titre était hyper accrocheur et résonnait avec plein de questions politiques que je me posais.
Quelles ont été vos influences pour la mise en scène ?
Camille : Sur scène, on a quatre couleurs : rose, bleu, argent, blanc. Je pense à Jacques Demy (ndlr : cinéaste français rattaché au mouvement de la Nouvelle Vague) pour les costumes ou à Wes Anderson qui influence beaucoup les choix de notre costumière.
De manière générale, j’aime bien tout ce qui est kitsch, que ce soit dans le jeu ou les esthétiques un peu outrées et « too much ». Ça peut être aussi un outil de contestation politique, dans le sens où, plus on met de la norme, plus on grossit les traits de certaines choses, moins ça a de sens. La question du rapport femme/homme est très présente. Dans la famille, on a des femmes ultra-puissantes face à des hommes extrêmement passifs, qui ratent tout ce qu’ils font et qui ont du mal à correspondre au rôle que la société souhaite leur imposer.
Dans la pièce, lors d’un interlude musical, vous répétez les paroles « Ne nous faites pas chier avec ça », à qui s’adressent ces mots ?
Camille : Ah oui ! C’est la mère qui le dit en premier alors qu’elle défend justement la sécurité. Elle adore par exemple le fait de pouvoir se faire scanner à l’aéroport, les médicaments... La pièce pointe du doigt cette espèce d’engagement politique qui n’en est pas un, ce discours du « tous pourris. ». Ces paroles s’adressent au public, ça va avec cette idée de normes et avec le « chacun pour soi » qui se développe en réaction.
Henry : Cela veut dire laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre notre délire consumériste, arrêtez de nous embêter avec votre politique, ça ne nous intéresse pas. Je fais ce que je veux, ma famille je la gère comme je veux, je me drogue pour me sentir bien, c’est tout évacuer à l’extérieur de toi, plus rien ne t’atteint. La chanson montre une dépolitisation complète.
La pièce a été écrite en 2012, pourquoi avoir choisi en particulier cet espace visuel et sonore qui croise les années 60 et 80 ?
Camille : Dans le texte, il y a plusieurs petits éléments qui nous empêchent de la situer de manière claire dans le temps. On sent quand même qu’il y a des choses relativement modernes.
Une atmosphère un peu rétro-futuriste...
Henry : Il y a beaucoup de passages où les personnages parlent d’une forme de fin du monde, d’une société humaine qui a été au bout de ce qu’elle pouvait apporter. On sent qu’il y a eu une chute et qu’ils sont dans un au-delà très artificiel, virtuel, normé...
Camille : Cela pourrait aussi bien se passer il y a 40 ans que dans 100 ans, donc on s’est dit qu’on allait faire quelque chose qui mélange un peu les époques. On est parti sur les années 80 parce que c’est une époque de fantasme sur les technologies, les fusées, les humains-robots… Tout semblait possible. Ce qui est drôle c’est que c’est une époque qui a beaucoup repris aux années 60 : par exemple, Mars Attacks ! reprenait des petites cartes postales de ces années-là !
Henry : C’est dans ces années-là qu’a été écrit le Rocky Horror Picture Show et beaucoup d’autres films de ce genre-là qui allaient vers une sorte de libération, quelque chose de l’ordre de la contre-norme.
Quel est le rôle de la musique dans la mise en scène ? Quel a été le processus créatif du compositeur ?
Camille : Le texte est un texte musical. Avec Victor (le compositeur), on s’est d’abord demandé quelle esthétique on voulait pour chacune des chansons. J’en voulais une avec une esthétique très B-52’s, une nostalgique style diva-Dalida, et ensuite on s’est dit que l’on voulait une musique des années 80 avec du synthétiseur. Je lui avais donné comme consigne que la musique devait grossir et aller de l’acoustique (quelque chose de très humain) à quelque chose de beaucoup plus électronique. Au début on a une chanson au ukulélé. Pendant la deuxième partie, c’est très électro et beaucoup moins mélodique. Il adore tout ce qui est kitsch comme moi, et ça a vraiment coulé de source, on était sur la même longueur d’ondes.
Et pour le décor ?
Camille : En fait, il y a trois parties. Le texte est construit comme la Divine Comédie de Dante, avec l’Enfer, qui est le repas de famille au début ; le Purgatoire, avec cette espèce de parole qui se libère, qui brasse des choses de la société et qui est adressée au public. La première est relativement classique, on a des repères : une table, des chaises, une famille… À partir de la deuxième partie, le plateau se vide entièrement, il n’y a plus aucun élément de décor, on passe au blanc dans les costumes. Même dans la manière dont c’est écrit : dans la première partie, on a des noms de personnages avec des répliques et à partir de la deuxième partie, on n’a plus que des tirets, et c’est moi qui ai distribué les répliques.
Du coup, cette partie-là est beaucoup plus adressée au public, tandis que dans la première partie, au contraire, on était dans un huis-clos où les personnages se parlaient entre eux. Dans cette deuxième partie, ils perdent de leur identité et on n’a plus que leur enveloppe : dans les répliques de la première partie, on a la « grand-mère » et le « grand-père » et dans la deuxième partie, ça se transforme en « vieil homme » et « vieille femme ». Pour essayer de transmettre ça, on a choisi le blanc parce que ça allait avec le côté « médical », « futuriste » et ça allait aussi vers une forme de neutralité. Les personnages sont tous habillés pareil, on les perd.
Vous parlez de Dante. On voit bien l’Enfer, et même le Purgatoire, mais le Paradis ?
Camille : C’est très cynique de la part de Crimp parce qu’en fait on n’a pas un paradis du tout, on a un paradis artificiel : notre dernière partie n’est quasiment que de la vidéo-projection. Cette troisième partie évolue vers une robotisation, une « technologisation », ce sont les humains qui deviennent de plus en plus « technologiques », on perd progressivement l’humanité pour arriver vers ce paradis où il n’y a plus que deux personnages : Madeleine et Bob, ceux qui provoquent une dispute familiale dans la première partie. Ce que j’essaie de raconter, c’est l’histoire de quelqu’un (Madeleine) qui ne supportait tellement pas l’imperfection humaine qu’elle s’est dit que ce serait mieux de ne plus être humaine du tout. D’ailleurs, c’est ce que dit la grand-mère dans sa tirade dans la première partie : « Je rêve d’un humain qui ne serait plus humain du tout », un humain qui se transforme, dans la troisième partie, en être technologique.
Et quel est votre rapport à l’espace ?
Camille : On est content d’avoir un grand plateau à Nanterre sur Scène parce qu’on a seulement joué dans des petits espaces. Ici c’est un challenge ! La pièce en elle-même est entre le théâtre public et le théâtre privé, elle a un côté music-hall et en même temps Crimp est ancré dans le théâtre public. Le chapiteau et le cirque je trouve ça intéressant parce que je trouve que c’est la seule chose qui va à la fois dans le privé et dans le public, ça n’a pas d’étiquette. Et de manière générale, ces formes moins « nobles » comme le cabaret m’intéressent beaucoup. On a des atomes crochus avec le chapiteau !
Propos recueillis par Elsa Mahi et Suzanne Cras