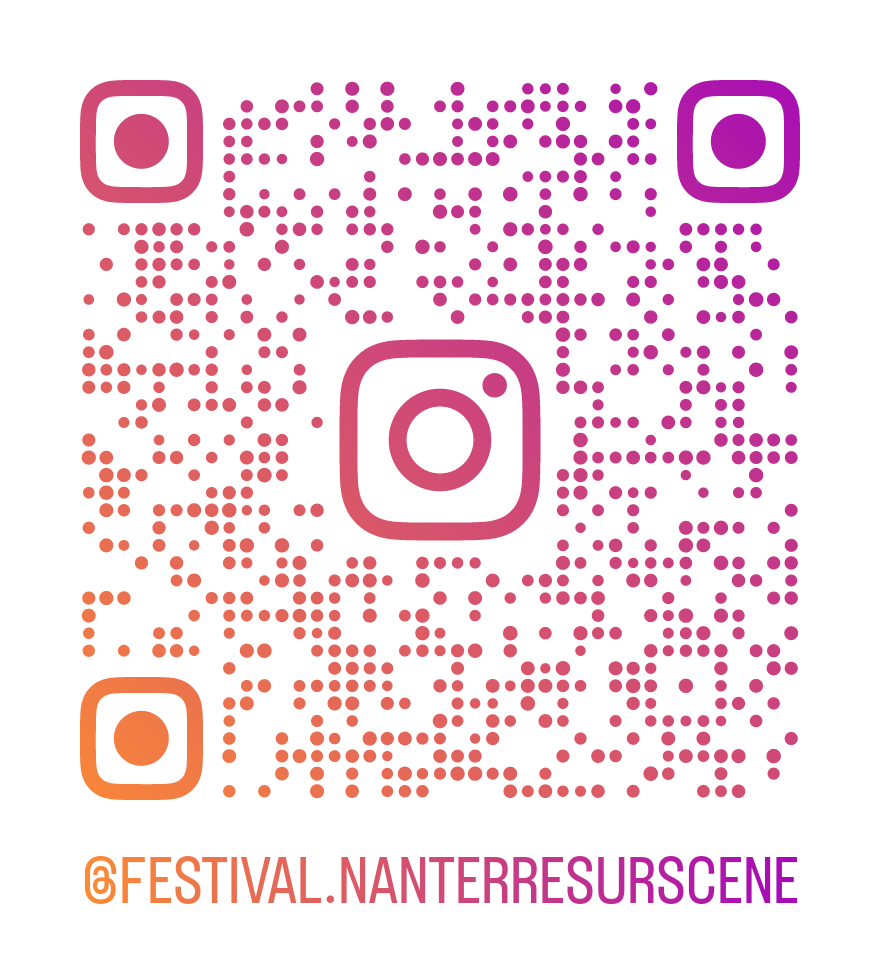L'histoire du communisme racontée aux malades mentaux
par Les Doux Affreux
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique
Date : Jeudi 29 novembre 2018
Horaires : 20h30 - 21h30
Lieu : Le chapiteau des Noctambules
Durée : 1h
Discipline : Théâtre

Tom Burns
Mise en scène : Lisa Toromanian
Avec : Logann Antuofermo, Clémentine Aussourd, Salomé Ayache, Mohamed Belhadjine, Teddy Chawa, Ahmed Hammadi Chassin, Alexandre Manbon, Nadine Moret et Lisa Toromanian
En 1953, à Moscou, quelques semaines avant la mort de Staline, le directeur de l'Hôpital Central des Malades Mentaux imagine une expérience particulière : il invite un écrivain, Iouri Petrovski récompensé par le Prix Staline, pour un séjour au milieu des malades et lui demande de réécrire, au niveau d'entendement des débiles légers, moyens et profonds, l'histoire du communisme et de la Révolution d'Octobre... La direction croit que cette "thérapie" pourrait guérir certaines maladies mentales. Montrer la force thérapeutique de la pensée communiste, voilà le but de la venue de l’écrivain Iouri Petrovski.
Mais qui est fou ? Dans cet hôpital Psychiatrique aux allures de Koulak déguisé, on ne sait plus qui est qui. On y croise des malades aux noms étrangement familiers à l’histoire du communisme, et des membres du corps médical bien plus fous que nos malades.
« IOURI PETROVSKI - Ouvrez largement la bouche. Dites « u ». Respirez. Remplissez d’air vos poumons. Dites « Utopie ». Donc c’est quoi une utopie ? Une utopie c’est lorsque qu’on est dans la merde et qu’on veut en sortir. Mais avant de sortir de la merde il faut y réfléchir. Alors tu réfléchis et tu vois que tu ne peux pas sortir de la merde tout seul, tu ne peux sortir de la merde qu’avec les camarades qui sont avec toi dans la merde. Mais ceux qui t’ont foutu dans la merde ne veulent pas que tu sortes de la merde. Car ceux qui t’ont foutu dans la merde sont forts, car ils sont unis. »
Entretien
Il peut sembler compliqué d’aborder un sujet politique tel que le communisme au théâtre. Etait-ce pour vous un pari risqué ? Pourquoi avez-vous fait ce choix ?
Le sujet du communisme au théâtre n’est pas pour moi un sujet plus risqué qu’un autre. Je parlerais plutôt de sujet nécessaire. Mes origines viennent de l’URSS : ma famille toute entière y a vécu, mes parents y sont nés et y ont grandi, certes après la mort de Staline, mais ils ont néanmoins évolué sous son ombre. J’ai grandi entre deux grands-pères complètement opposés : Nerces Toromanian, amoureux fou de Staline et Lénine, qui a fait partie du gouvernement communiste arménien et n’a jamais changé ses convictions communistes; contre Harout Karahanian. Né à Marseille, lui a décidé à dix-huit ans de retourner en Arménie, sans rien savoir de ce qui s’y passait. Sur place, la prison se referme : son passeport lui est confisqué et il ne pourra pas repartir. Il passera trente ans à rejeter ce gouvernement « de cons ». Je suis donc le fruit de cette opposition et il n’y avait, pour moi, pas de plus bel hommage que de monter cette pièce. Visniec, qui l’a écrite, fait un joli pont entre mes deux grands-pères, tout en dénonçant l’effroyable fiasco du pouvoir communiste. Il rappelle également la beauté de l’idéologie communiste en soi.
Vous êtes neuf sur scène et représentez pourtant trente rôles différents. Cela doit nécessiter une forte complicité au sein de la troupe ! Quel lien entretenez-vous entre vous ? Et avez-vous l’habitude de travailler ensemble ?
Avec tous les membres de la compagnie, nous nous sommes rencontrés au Conservatoire national supérieur d’art dramatique et l’on est devenu à la fois un groupe de travail et un groupe d’amis. On avait les mêmes idées : ne pas attendre, créer, jouer, vivre fort et ensemble ! On s’est donc vite réunis autour de cette pièce. Notre but est avant tout de rechercher et de créer ensemble un théâtre qui nous est propre.
Venus d’horizons et de parcours différents, c’est en groupe qu’on désire avancer et grandir. Sans attendre qu’on vienne nous chercher. Ensemble!
Dès la lecture du titre de la pièce naît un paradoxe flagrant : pourquoi raconter l’histoire du communisme à des « malades mentaux » qui sont, a priori, un public en dehors de la vie politique ?
C’est en essayant justement de simplifier les choses, selon moi, qu’on se rend compte de l’absurdité d’une situation. Iouri Petrovski est invité à un séjour au sein de l’hôpital pour raconter l’histoire du communisme et la révolution d’Octobre au niveau d’entendement des malades mentaux. Iouri donc, en nous expliquant ce qu’est le communisme de manière simplifiée, nous montre en fait à quel point le communisme stalinien a été d’une absurdité totale, à quel point l’idéologie qui devait résoudre les problèmes de l’humanité a été détruite. C’est donc cela le but du décalage, qui d’ailleurs nourrira tout au long du spectacle l’humour de la situation.
La folie est une tradition qui a longtemps habité le théâtre. Sur scène, les puissants sont souvent accompagnés de bouffons, de fous qui avaient comme rôle de faire passer un message par le rire, de faire comprendre que par la folie, on accède finalement à la sagesse. S’agit-il dans votre pièce du même type de folie ?
On peut comparer la lucidité des bouffons royaux à celle des malades mentaux du spectacle. Jouer aux fous, voilà leur point commun. Toutefois la « folie » des bouffons est faite pour faire rire le spectateur alors que dans la pièce, la folie des malades mentaux est faite pour qu’on se cache derrière elle. Bien que par moment, la folie puisse faire rire le spectateur, il s’agit d’un rire complètement différent.
C’est vrai : on rit devant certaines scènes qui pourtant ne sont pas drôles. Comment et dans quel but parvenez-vous à provoquer ce rire sur votre public?
L’histoire du communisme racontée aux malades mentaux est une comédie. Elle est faite pour rire, même si elle parle d’un sujet complexe dont peu de monde connaît les détails précis (par exemple le fait qu’on envoyait les opposants politiques dans les hôpitaux psychiatriques). Nous cherchons à faire rire, certes ; mais il s’agit d’un rire construit qui ne vient pas de l’aspect comique mais du paradoxe de la pièce. On cherche le rire pour faire réfléchir, c’est d’ailleurs le filon principal que Visniec utilise dans sa pièce. Le médiocre côtoie le médiocre et qu’est-ce que c’est drôle ! Et par le rire, le spectateur met de la distance avec ce qui se passe sur scène, c’est une réponse à la surprise.
Ce rire est également provoqué par le jeu d’acteur des malades mentaux, qui est très différent de celui des autres personnages. Comment ces rôles sont-ils pensés et travaillés ?
Il y a en effet deux jeux très différents : celui des « habitants » de l’hôpital psychiatrique (pas seulement les malades mentaux mais aussi la direction de l’hôpital ou l’infirmière) qu’on pourrait qualifier de « surréaliste ». Et celui de Iouri Petrovski, qui est le seul personnage qui vient de l’extérieur, loin de tout cet univers, et adopte alors un jeu plus « naturaliste », plus sensé. Cette opposition est marquée visuellement puisque au contraire des clowns, habillés et maquillés en blanc et aux corps plus étranges, l’écrivain est habillé très simplement. Donc dès le début, le spectateur remarque visuellement l’opposition entre ces deux univers. C’était le but premier de cette mise en scène.
Ce contraste visuel est d’autant plus visible que vous choisissez une scénographie très épurée : un lit, une table, quelques chaises et un écran géant. Le tout dans des espaces distincts, découpés par des jeux de lumière. Pourquoi ce choix de mise en scène ?
Cela répondait plutôt à une question pratique. La pièce de Matéi Visniec se déroule dans de multiples endroits distincts. Mais au théâtre, personnellement, je déteste les changements de décor, je trouve qu’ils sont maladroits et cassent le rythme. Du coup, j’ai voulu créer la mise en scène autour de trois espaces distincts, découpés précisément avec la lumière. On passe très rapidement d’un espace à l’autre : la chambre de l’écrivain, le bureau du directeur et l’espace des malades mentaux. Cette rapidité permet aussi d’apporter un rythme particulier qui s’accorde bien avec l’écriture laconique de Visniec.
À la fin de la pièce, on voit l’écrivain Petrovski rejoindre l’univers des malades mentaux en se maculant à son tour le visage de blanc. La folie serait-elle contagieuse?
L’écrivain ne rejoint pas totalement l’univers des malades mentaux à la fin. En fait, il ne devient pas fou: il bascule plutôt, en quelque sorte, du côté de la connaissance. Mais cela aurait été compliqué à mettre en scène, j’ai donc préféré le faire basculer petit à petit, physiquement, dans l’univers des malades mentaux. Dans l’une des scènes, il se met même à parler comme eux « click, clack, pouf ! ». C’est en fait la connaissance qui est contagieuse : le public, à son tour, va se rendre compte que ces « fous », quand ils sont en dehors de tout contact avec le personnel soignant de l’hôpital, sont en fait très lucides.
Du coup, certaines scènes, comme celle que vous venez d’évoquer, sont porteuses d’un message politique très fort. Vous utilisez votre art comme un combat politique : quel impact votre pièce pourrait-elle avoir dans notre société actuelle, avec notamment la montée des extrêmes ?
Je me suis toujours dit cette phrase un peu bateau : « connaître son passé pour aborder au mieux son futur ». En France, on assiste à une montée des extrêmes, cachée sous de belles phrases, de belles promesses et de beaux sourires. Le communisme stalinien sur le papier était le plus bel avenir possible pour l’URSS. Matéi Visniec le dit si bien : « l’un des plus grands drames du XXe siècle, c’est que le communisme n’a pas réussi ». Parler d’hier et d’aujourd’hui est en effet le but de notre art, et avec cette pièce, on fait le pont entre l’URSS de 1953 et le 2018 de notre monde occidental. Les foules aliénées des années soviétiques semblent toujours exister aujourd’hui. La manipulation, la fragilité humaine, le mensonge politique et la folie totalitaire font toujours autant notre quotidien.
Propos recueillis par Victoria Saad