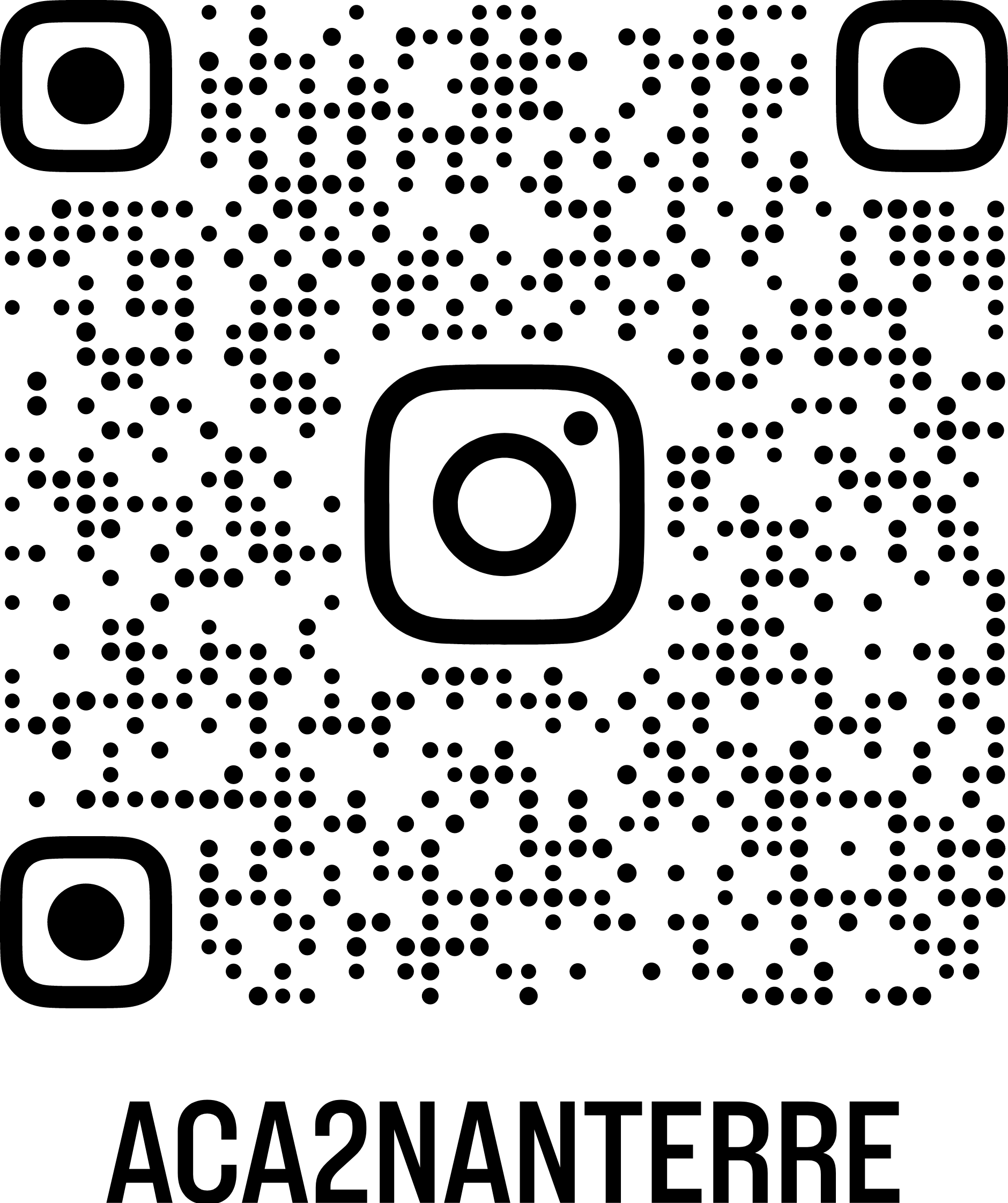KÉRATOCONJONCTIVITE
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Date : Mardi 1er décembre 2015
Horaires : 18h30 - 19h30
Lieu : Espace Pierre Reverdy
Durée : 1h
Discipline : Théâtre

© Rémi Durand
- Mise en scène : Mathieu Barché
- Interprétation : Clément Durand
Voulant vivre une histoire d’amour selon les principes d’un romantique absolu, un jeune homme entretient une relation fantasmée avec un chevreuil. Ces deux compagnons souhaitent résister ensemble au mode de vie consumériste et urbain imposé par la mondialisation et la globalisation grandissante. Le jeune homme s’est reconstruit un espace naturel à partir d’arbres morts dans un espace bétonné, à l’intérieur duquel il peut vivre cloitré avec Chevreuil et poursuivre ses activités quotidiennes liées au monde civilisé tout en respectant son idéal romantique.
KÉRATOCONJONCTIVITE nous montre une heure de la vie d’un jeune homme. Nous le voyons évoluer dans son écosystème autonome, lui insuffler la vie chaque matin, faire le jour et la nuit, la pluie et le beau temps. Mais son écosystème est fait également d’émotions, de sensations, d’impressions qui rythment sa vie. En les contrôlant grâce à toute une artillerie de machines électroniques (un lecteur vinyle, des projecteurs, une machine à fumée...), il enrobe chaque instant de sa vie d’une émotion plus ou moins complexe, d’une énergie qui le pousse à agir, comme une matière vitale dans laquelle il peut se mouvoir. Ainsi, dans son espace clos, espace d’expérimentation, il peut revivre la sensation de l’aube naissante, du gazouillement de l’oiseau, revoir les images de sa vie passée en musique, tanner sa peau contre la brise du ventilateur, se confronter toujours à l’épreuve du temps de la nature qui agit sur l’homme, le nourrit, le stimule, et le fait grandir, lui et son esprit.
Avec un regard d’entomologiste, le spectateur est invité à voir quelles sont nos occupations, comment, en étant attentif au plus petit de nos actes et aux détails de notre environnement, nous pouvons faire renaître la vie au sein même de chaque chose qui nous entoure, dans chaque détail. Le milieu où vit l’homme engendre des occupations, et inversement, l’occupation définit la vie qui s’y trouve, et elle peut être partout. Gaston Bachelard écrit : « Prendre une loupe c’est faire attention, mais faire attention, n’est-ce pas déjà avoir une loupe ? L’attention à elle-seule est un verre grossissant. De toute part, le poète fait jaillir les images. Il nous donne un atome d’univers en multiplication. Guidé par le poète, le rêveur, en déplaçant son visage, renouvelle son monde. »
Présentation de la compagnie
La Compagnie La Chevauchée, dirigée par Mathieu Barché et administrée par Agathe Perrault, est née en 2015. Depuis, trois créations ont vu le jour : HIVERS d’après des textes de Jon Fosse, PLATEAU N°1, une écriture de plateau collective et KÉRATOCONJONCTIVITE. Les comédiens de ces trois spectacles, ainsi que le metteur en scène Mathieu Barché viennent de l’école du Studio d’Asnières où ils se sont rencontrés. Les projets réalisés ont en commun de vouloir questionner notre rapport à l’émotion dans la construction de la fiction et dans la vie, en essayant de dévoiler aux spectateurs les codes de jeu qui régissent le rapport triangulaire comédien/espace/public, pour que ce dernier entretienne un rapport ludique et constructif au spectacle et à l’émotion.
Entretien mené par Alice Sammut, étudiante en Master 1 Humanités et Industries créatives à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Lorsque je retrouve Mathieu Barché et Clément Durand, en fin de matinée, dans le 7e arrondissement de Paris, pour discuter avec eux du spectacle Kératoconjonctivite, j’avoue être impatiente d’en savoir un peu plus à la fois sur cet OVNI, débarqué au festival Nanterre sur Scène, et sur ses deux jeunes créateurs.
Pourriez-vous me parler de la naissance du projet Kératoconjonctivite ? Comment a-t-il été construit et dans quel contexte ?
Clément Durand : À l’origine Kératoconjonctivite est un solo créé dans le cadre d’un exercice à réaliser seul, lorsque j’étais à l’Atelier Volant, au Théâtre National de Toulouse. À la fin du cursus, nous présentions ce solo mis en scène, avec l’aide de la dramaturge Charlotte Farcet. J’ai présenté cette première version de 45 minutes à Toulouse et, par la suite et sans trop de modifications, à Asnières dans le cadre du festival Mises en Demeure. À la suite de cette dernière représentation, j’ai fait part à Mathieu [Barché, metteur en scène] de mon envie de reprendre le projet et de le faire évoluer. Je voulais travailler avec un regard neuf sur ce projet. C’est tout naturellement que l’idée nous est venue de le présenter à Nanterre sur Scène.
Avez-vous modifié le projet initial de Clément lorsque vous avez décidé de travailler à deux ?
Mathieu Barché : Des questions restaient encore en suspens. La question de la communication entre Renard et le personnage par exemple. D’autres questions nous apparaissaient primordiales : comment faire avancer l’action ? que devient la prise de parole ? Presque sans qu’on le décide, la prise de parole a disparu. Mais la première chose que nous avons faite a été la création d’un environnement, un endroit agréable à vivre pour le personnage, où pouvait se dérouler l’histoire. Pour cela, nous sommes allés chercher des arbres directement dans la nature. Le décor est devenu presque comme un troisième personnage, avec qui le personnage de Clément interagit, par exemple lorsqu’il danse. Ce n’est que par la suite que nous avons réfléchi au déroulement de l’action.
Vous parliez à l’instant de l’environnement dans lequel évolue votre personnage durant le spectacle. Il donne l’impression d’un paradis artificiel qu’il se serait créé, était-ce une idée présente dans la première version ?
C.D. : À l’origine cela l’était moins : j’avais très peu de moyens, ne serait-ce que des outils pour couper les arbres. Je ne pouvais que suggérer la chambre des rêves que nous avons essayé de recréer ensuite. Le décor évoquait davantage l’enfermement qu’un espace que le personnage investit pour s’en faire un paradis artificiel, en y amenant ses utopies, sa rêverie, sa poésie... Dans cette nouvelle version, c’est beaucoup plus présent. Avec une vraie scénographie comme celle-ci, qui en dit beaucoup, on peut se permettre de ne pas avoir de prise de parole. Cela permet d’être moins dans le bavardage : dans la première version, je devais tout commenter pour combler le vide du plateau.
M.B. : Personnellement, j’ai l’impression que la voix-off normalise : je trouve cela agréable pour le spectateur, parce qu’il lui manque par ailleurs beaucoup de clés de compréhension. Au début du spectacle, on se dit : « Est-ce que le personnage est chez lui ? Qu’est-ce qu’il fait ? Pourquoi vit-il comme ça ? ». On peut même se demander si c’est une sorte de défenseur de l’écologie qui prépare une bombe atomique avec des plantes vertes. La voix-off permet de répondre à ces questions. Elle explique au spectateur que ce lieu est la maison du personnage, comme n’importe quelle autre maison, avec son fonctionnement propre. Je trouve que le terme de paradis n’est pas approprié, parce que c’est un lieu normal que le personnage a idéalisé en le créant selon son désir. Mais ce n’est pas forcément un paradis : il peut y manquer des choses. C’est un endroit où il a des occupations quotidiennes, qui sont celles du maintien de la vie des arbres, de Chevreuil, et de lui-même.
Dans la première version, y avait-il déjà un texte écrit, où était-ce de l’improvisation ?
C.D. : Dans un premier temps, j’avais une trame : certaines choses étaient écrites, d’autres moins. Mais de manière générale, je me suis rendu compte que tout ce qui n’était pas écrit venait en surplus par rapport à l’histoire, et relevait davantage du commentaire. La nouvelle version me semble plus précise, dans le sens où la voix-off soutient la narration et oriente le spectateur. Cela permet également de supprimer les éléments superflus de la première version.
Quelles ont été vos sources d’inspiration pour ce projet ?
C.D. : Kératoconjonctivite vient de plusieurs sources d’inspiration, tout d’abord cinématographiques : il y a le documentaire Grizzly Man de Werner Herzog, des films de Chantal Akerman, notamment Je, tu, il, elle. J’ai été influencé par des photographies aussi. Elles représentaient des animaux morts, notamment des chevreuils dans des situations très différentes. Il y avait des photographies de chevreuils noyés dans des piscines, des rivières, certains étaient même tagués… Ces photos ont constitué mon iconographie pour écrire l’histoire d’amour avec Chevreuil. L’idée d’une relation avec un animal sauvage me plaisait, cela permet de flirter avec le fantastique et d’accentuer l’aspect fantasmé de cette relation. Au début, j’utilisais également un renard empaillé. Renard était simplement un compagnon de vie alors que Chevreuil est clairement l’amour déchu du personnage. Depuis, nous avons déplacé le cœur du sujet, les relations entre le personnage et les animaux ont évolué. À force de retravailler le spectacle, nous nous sommes aperçus que la relation avec Chevreuil et l’histoire d’amour prenaient le pas sur la relation avec Renard au point qu’il n’avait plus besoin d’exister.
M.C. : Chevreuil était l’amour mort et Renard le confident. Maintenant on a décidé de faire ressurgir le mort.
Pourquoi avoir choisi comme titre le nom d’une maladie, la Kératoconjonctivite ?
C.D : C’est une métaphore de la solitude. Les animaux qui en sont atteints se retrouvent aveugles. Ce sont généralement des animaux qui vivent en troupeaux. La première fois que j’en ai entendu parler, c’était durant une randonnée dans les Pyrénées. Le guide expliquait que c’était une année terrible pour les isards : ils étaient complètement décimés à cause de la Kératoconjonctivite. Ce qui est terrible c’est qu’en devenant aveugles, ils perdent le contact avec le groupe. Généralement soit ils meurent de faim, soit ils se fracassent contre les rochers et tombent dans des précipices. Je voulais évoquer cette forme de solitude sur le plateau. Dans les premières versions, le personnage expliquait concrètement ce qu’était la Kératoconjonctivite. Il allait jusqu’à l’éprouver pour tester la capacité de Renard à pouvoir l’aider. Le personnage se cachait les yeux et devait courir contre un mur pour voir si Renard l’arrêtait ou non. Un peu comme Marina Abramovic le faisait dans ses performances. Mais je n’arrivais jamais à ne pas m’arrêter comme elle le faisait, en réalité c’est très dur. Comme ça ne fonctionnait pas, j’ai choisi de faire autre chose : c’était moins performatif, donc plus suggéré. Je me cassais la figure sur des rouleaux de fer et à partir de là je prenais conscience que Renard n’était pas vraiment un compagnon puisqu’il ne m’avait pas arrêté. Je le brûlais et partais, je n’avais plus de raison d’être.
Vous avez voulu parler de la solitude, c’est le thème qui apparaît, à mon sens, le plus manifeste dans votre spectacle, mais y en a-t-il d’autres ? Et de quelles manières avez-vous choisi de les traiter ?
C.D. : Le personnage est moins isolé que cela ne l’a été dans la première version. Nous informons le spectateur qu’il travaille, qu’il a un quotidien. Mais plutôt que d’aller boire des verres le soir, il passe du temps avec ses arbres. Comme pour trouver la force de révéler son véritable visage au monde. Peut-être qu’après coup, s’il perçait dans la chanson, il pourrait de nouveau aller boire des verre avec ses amis. Les autres thèmes sont venus un peu au fur et à mesure. Le rapport à la nature me paraît important, d’autant que c’est un thème important cette année avec la COP21. Il fallait que le personnage ait une conscience écologique, ses arbres sont les derniers qu’il ait pu sauver. Mais je crois que cette idée est moins d’actualité, il fallait transposer le contexte du spectacle dans un futur qui n’est pas nécessaire. Au final, ses actions auprès de la nature lui donnent une vraie importance, même si elles relèvent du fantasme. Il pose des feuilles avec de la Patafix, il n’a pas cet acte régénérateur comme lorsque l’on sème. Mais cela lui procure un confort émotionnel et justifie son existence pour contrer tout ce qu’il ne trouve pas dans son quotidien au travail – on l’imagine banquier. Peut-être que, d’une certaine manière, c’est dans l’inutilité et l’absurdité qu’il trouve une forme de bien-être.
M.B. : Il y a une profonde mélancolie à vouloir garder un bout de vie dans chaque chose. Lorsqu’il éteint toutes ses machines, c’est comme la fin d’un rêve intérieur. Il doit également faire le deuil d’un amour qu’il arrête d’un seul coup et décide d’oublier. L’arrêt des machines crée un vide énorme, toute son activité remplissait ce vide. Au final on a presque l’impression qu’il ne s’est rien passé. Si on y réfléchit d’ailleurs, il ne s’est pas passé grand chose. Mais ce que j’aime bien c’est que ce soit quelqu’un qui ait tout créé de A à Z, du climat jusqu’au temps, pour tout gérer. Se dire que pour lui une nuit peut durer dix minutes s’il décide de rallumer les projecteurs. Il a même le pouvoir de se créer des émotions. Aujourd’hui, pour créer des émotions il suffit de s’acheter un ordinateur et on peut faire de la musique, un film, de très belles photographies. On est tous de potentiels super-créateurs d’émotions très fortes. On s’est posé cette question justement, de la création des émotions et de ce qu’elles nous procurent, dans une de nos précédentes créations, Plateau N°1. Comment une fiction peut-elle provoquer en nous une émotion ? Comme lorsque l’on voit pleurer quelqu’un et que l’on pleure à son tour.
Cherchez-vous à mettre à nu la réalité ?
M.B. : Pas forcément. Nous ne dévoilons pas les ficelles du spectacle ! Cela fait partie du monde du personnage, c’est une manière de montrer comment il se construit une émotion ou une tempête. Une tempête, cela peut être juste une feuille avec un ventilateur, une machine à brouillard et un vinyle qui tourne. Le public le voit mettre le vinyle, appuyer sur le bouton du ventilateur et mettre son k-way. Nous utilisons beaucoup l’image du DJ qui crée un beat, rajoute des sons, les superpose. Pour le personnage c’est presque pareil, ce sont des ambiances : il met une lumière qui crée des rayons du soleil, il met donc des bruits d’oiseaux. Il affirme que c’est le printemps, donc le personnage va changer les fleurs des arbres.
Ce travail autour de l’émotion peut faire penser aux travaux des romantiques. Votre personnage semble s’inspirer des héros mélancoliques du début du XIXe siècle. Trouvez-vous le parallèle pertinent ?
M.B. : Je crois qu’on ne s’en inspire pas vraiment, même si on s’est renseignés là-dessus. Dans le romantisme, la nature est comme la continuité des sentiments intérieurs. Le rapport à l’émotion est présent, mais c’est le prolongement des émotions qui permet d’aller très loin. Cela me semble être quelque chose d’égocentrique : l’homme se retrouve seul face à la nature et à lui-même, c’est une manière d’illustrer sa vanité. Il y a des similitudes forcément ; mais je ne sens pas le spectacle, actuellement, proche de ces présupposés. Dans le projet initial, Clément s’en inspirait peut-être plus.
C.D. : Le personnage a connu cette étape du héros romantique. Cependant, il en est déjà à l’étape d’après. Par exemple il y aurait l’étape Kurt Cubain : on ne trouve plus sa place, on broie du noir. Lui, en revanche, a trouvé, grâce au mécanisme mis en place, un sas de décompression. Ce sas va lui servir de tremplin parce qu’à la fin il a une prise de conscience : il veut sortir et s’émanciper. Le héros mélancolique, que ce soit Kurt Cubain ou un autre, est dans une impasse que le personnage réussit à surmonter. Dans cette version du spectacle, le suicide n’est plus la finalité : dans la version initiale, le personnage brûlait Renard, c’était une manière d’évoquer son propre départ. Je pense que c’était en lien avec mon état d’esprit de l’époque, non pas que j’étais suicidaire, mais il y avait cette aspiration à la mélancolie que j’ai toujours trouvé très belle. Maintenant c’est plus optimiste, le personnage a su surpasser l’austérité de sa vie quotidienne pour atteindre ce qu’il est vraiment : un chanteur de chansons d’amour. C’est cette nature, sa relation avec Chevreuil qui lui permettent d’avoir ce regain de confiance en lui. Il peut alors se confronter à autrui. J’admets que c’est un premier pas vers l’autre extrêmement violent. Au début, on avait l’idée d’un speed dating avec le public. Mais la chanson d’amour m’apparaît plus appropriée. Est-ce que le monde peut accepter cet homme tel qu’il est ? Ou a-t-il besoin de passer encore un petit temps avec ses arbres ?
Cette confrontation, d’une certaine manière, sort le spectateur de la fiction. Était-ce une idée de départ de brouiller les pistes entre fiction et réalité ?
M.B. : Clément lui-même fait la voix-off, ce système permet de raconter l’histoire d’un comédien construisant un monde et rappelle qu’il ne faut pas oublier que nous sommes dans un espace réel, l’espace Reverdy. Un spectacle c’est une boîte à fiction, même si le spectateur a l’impression qu’il y a eu une tempête par exemple. Je trouve dommage de vouloir modifier le lieu qu’est l’espace Reverdy : il propose pleins de choses avec la verrière, et le simple fait de se dire qu’au-dessus c’est le ciel est plus agréable. Si jamais il pleut, cela peut donner des sons intéressants.
C.D. : Pour la confrontation du personnage à la réalité on imagine rallumer les lumières de services, créer une rupture avec la fiction. On voudrait qu’il soit simplement avec son petit ampli comme un chanteur de métro. Pourquoi vouloir absolument que ce soit un espace de théâtre alors que ça ne l’est pas ?
Vous souhaitez donc prendre en compte la réalité de l’espace dans lequel vous jouez. Votre spectacle a-t-il pour vocation d’évoluer en fonction de ces lieux? Cela implique-t-il des changements ?
C.D. : On ne voulait pas être sur la scène du théâtre Bernard-Marie Koltès. J’aime bien l’idée d’un personnage choisissant l’endroit où il veut s’installer. Et cela ne veut pas forcément dire mettre ses arbres en plein milieu d’un plateau. Quand j’ai créé ce projet, je l’avais imaginé pour investir les immenses sous-sols du théâtre de Toulouse. À la base, l’idée c’était d’avoir un endroit pas forcément lié à la représentation.
M.B. : Quand il l’avait joué à Asnières, Clément s’était mis quasiment dans les coulisses et les spectateurs étaient sur le plateau et regardaient en direction des coulisses.
C.D. : Au début j’imaginais que le personnage puisse amener son décor, toujours dans cette idée de jouer dans des endroits qui ne sont pas fait pour le théâtre. Il pourrait jouer cette histoire en boucle et le spectateur viendrait à un moment donné, comme lorsque l’on arrive dans une exposition et que l’on prend un film en cours. On a le choix de rester ou non. On a vraiment pensé la chose de manière frontale.
Dans cette recherche d’une représentation différente, on s’éloigne d’une représentation dite « classique », une pièce de théâtre dans un espace dédié. Le spectateur pourrait trouver des similitudes avec la performance. Est-ce que c’est quelque chose que vous recherchiez ?
M.B. : Dès son origine, le spectacle était plus proche de la représentation théâtrale que de la performance. Dans un autre contexte, nous aurions pensé la chose différemment. Au Centre Pompidou, par exemple, Clément serait resté pendant une semaine dans sa tente à faire Kératoconjonctivite. Faire un projet performatif me plairait, la performance a ses propres codes. De nombreux artistes s’attachent à définir ces codes et même s’il y a des liens entre performance et théâtre, les distinctions existent. Ce serait dommage d’affirmer que c’est une seule et même chose. Je ne dis pas qu’il faut tout ranger dans des cases, mais cela permet d’aller plus loin.
C.D. : Aujourd’hui, les éléments performatifs ont disparu. À Asnières, il y avait encore cette idée de tester Renard et de le brûler. Mais cela donnait une impression de caricature de performance. Maintenant ce n’est plus du tout le cas et la voix-off rapproche un peu de l’univers du conte.