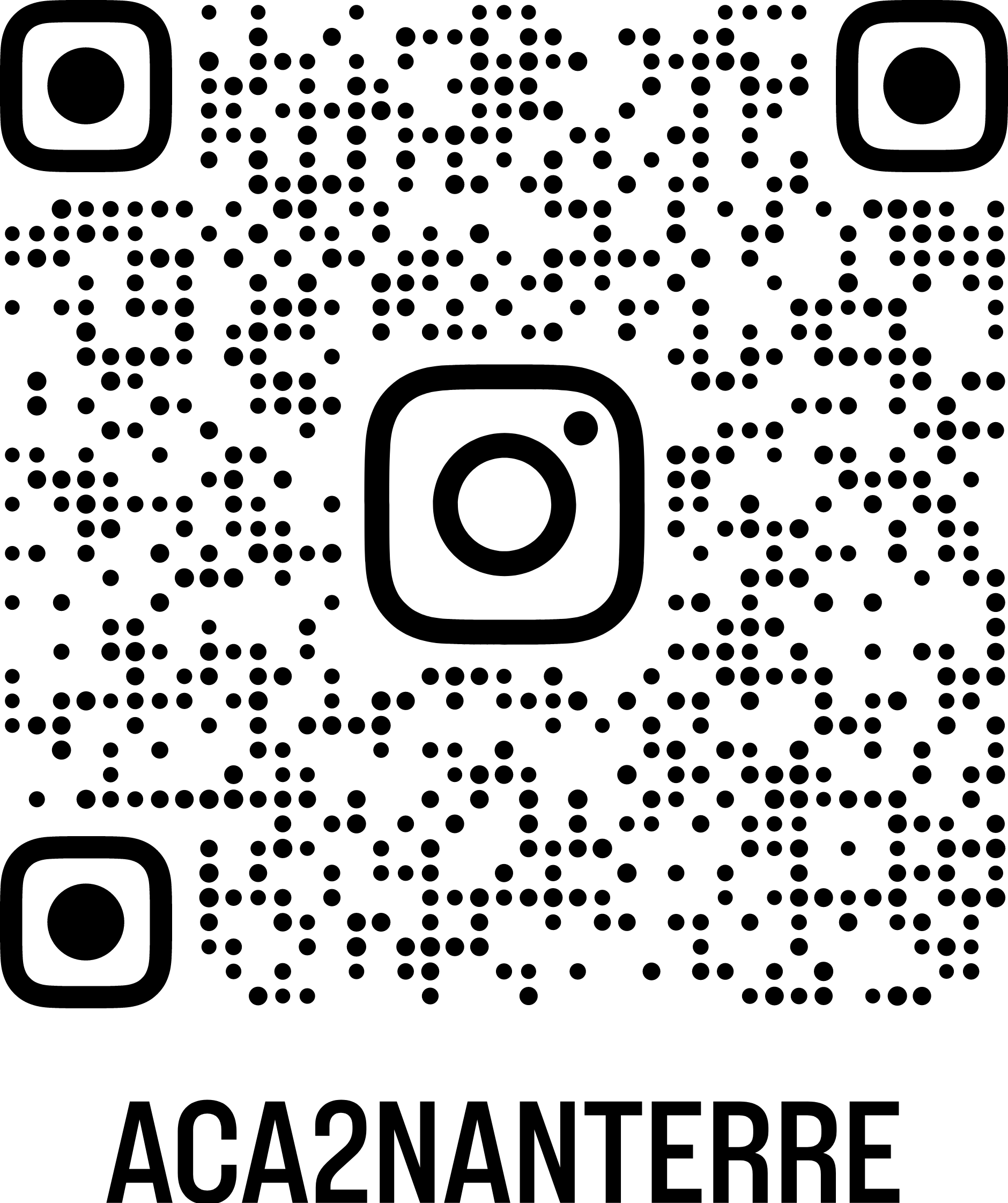Guillaume Cardineau
Mise en scène : Collectif Louvoyer Dodeline
Interprétation : Miléna Martin, Benjamin Fouchard et Guillaume Cardineau
Création musicale : Miléna Martin
Le Village et son silence. La nuit après la journée au travail. De la boue parterre, sur les pieds. Dehors, les champs. Le meunier, son moulin. Plus loin, le monde, la ville ? Ou Dieu.
Ici, le langage trouve sa matrice au cœur de la terre et des choses sur lesquelles on trébuche. Les poules. Les choses insignifiantes parce qu'inutiles pourtant lourdes d'histoires et de mémoires, seraient mères de la parole, force poétique témoin de l'attention qu'on porte au monde.
Les couteaux sont les noms. Ce monde proprement humain constitué par le langage est nécessairement mutilé. Nommer, pointer du doigt, transgresser: réduire la chose à un seul morceau imparfait d'elle.
C'est aussi notre salut, condition pour la liberté.
Entretien mené par Tahiana Danel, étudiante en Master 1 Humanités et Industries créatives à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Le collectif Louvoyer Dodeline passe à table. Rencontre avec Guillaume Cardineau (William, le laboureur), Benjamin Fouchard (Gilbert Horn, le meunier) et Miléna Martin (la jeune femme).
Le collectif « Louvoyer Dodeline » : voilà un nom bien curieux, d’où vous est-il venu ?
Miléna : Ce sont les deux mots qu’on préfère prononcer avec Guillaume.
Guillaume : On travaille sur un texte dont la question centrale est le langage, l’acte de nomination. On s’est dit que pour choisir notre nom, cela avait du sens de s’arrêter sur le plaisir de la prononciation, le plaisir de la diction qui est le nôtre à nous, comme comédiens.
Miléna et Guillaume vous êtes étudiants en philosophie, qu’est-ce qui vous a donné envie de monter une pièce de théâtre ?
Miléna : À la base, je viens de la musique, et Guillaume du théâtre. L’idée était sympa de regrouper musique et théâtre. Guillaume connaissait ce texte de David Harrower, Des couteaux dans les poules. Il nous manquait un personnage et c’est donc comme ça que Benjamin, qui a été formé au Conservatoire, nous a rejoints. On a vraiment formé le collectif autour de cette pièce.
Et comment la philosophie s’inscrit-elle dans votre création ?
Benjamin : La philosophie, c’est d’abord un choix de vie, une manière de vivre et de penser. C’est vraiment un matériau dont on s’est nourris pour monter cette pièce.
Miléna : Et puis la pièce est extrêmement philosophique. Elle interroge sur ce qu’on dit et pourquoi on le dit.
Benjamin : La philosophie est vraiment arrivée dès le début par le travail à la table de manière évidente. On a beaucoup discuté du texte, pendant des semaines, avant de monter sur le plateau. C’est un texte qu’on a tellement pensé qu’il nous semble ancrés dans nos corps, une fois sur le plateau.
Miléna : Il y aussi une réflexion politique autour de l’ambivalence de la libération. La jeune femme veut s’extraire de l’obscurantisme dans lequel elle se trouve : la pièce s’interroge pour savoir comment est-ce qu’on y arrive et quelles en sont les conséquences.
Guillaume : Deux phares ont guidé philosophiquement notre travail. Il y a d’abord l’aspect métaphysique. On parle du rapport au monde, des manières dont le langage interfère dans notre perception des phénomènes. Et puis, il y a quelque chose de plus politique, à partir de Marx notamment. Marx, c’est une pensée de la conscience et du travail : le fait de travailler dans un champ ou dans un moulin détermine la façon de penser des personnages. On a eu la chance de monter la pièce initialement dans la fac et donc d’être aidés par des amis en philosophie, d’avoir des retours précis. C’était très riche. Pour l’anecdote, lors de la première représentation, on avait mis dans l’un des sacs de grain Le Capital de Marx. La philosophie est arrivée très concrètement au plateau non pas par nous, mais par un effet scénographique invisible !
Vous avez décidé de vous former en collectif, ce qui implique une organisation particulière. De quelle manière vous êtes-vous organisés lors du processus de création ?
Tous : C’est vraiment difficile... [rires]
Guillaume : Il y a eu des nécessités en fait. Par exemple, Miléna est toujours sur le plateau... Miléna : ... et du coup j’ai l’impression que vous deux avez plutôt pris en charge la mise en scène. Et comme je joue du violoncelle, j’ai composé la musique. Je trouve qu’on a la chance d’avoir des expériences qui se recoupent tout en étant assez différentes finalement.
Tout ce travail de discuter longuement entre vous permet de gagner en efficacité puisque vous semblez avoir acquis le même langage, vous donnez l’impression de savoir où vous allez...
Guillaume : Oui, c’est un processus efficace dans le sens où la certitude est au maximum, même si elle vient après une longue réflexion. On prend plaisir à débattre, même si ça peut parfois être houleux. On a passé un an à réfléchir à « pourquoi on nomme les choses », et en même temps ça nous ouvre à d’autres possibilités comme s’exprimer par la musique. C’est fabuleux.
Miléna : Je trouve aussi que c’est la satisfaction que l’on a depuis quelques temps lorsque nous parlons de notre pièce aux gens. On est arrivés à un tel degré de consensus, que les lignes directrices sont claires et qu’on est tous les trois d’accord sur énormément de choses.
Guillaume : On en est même arrivés à utiliser un vocabulaire qui nous est commun...
Benjamin : La formation en collectif nous a fait nous questionner sur la manière de parler aux autres, et de se parler entre nous. Cela a également nourri la pièce et la façon dont on voulait la travailler.
En montant Des couteaux dans les poules, vous avez choisi de vous appuyer sur un texte existant. Pourquoi avoir préféré une adaptation à une création originale ?
Miléna : On était partis pour écrire quelque chose sur les petits riens qui finissent par prendre de la place dans nos vies, avec l’idée d’en faire un patchwork. Et en fait, assez vite Guillaume a ramené ce texte-là où le simple mot « comme » sur lequel bute la jeune femme dans la première scène déclenche toute la pièce.
Guillaume : Oui, et puis, de manière très pragmatique, aucun de nous trois n’est écrivain. Quand j’ai retrouvé ce texte-là, finalement on ne s’est pas posé la question longtemps, on a foncé dedans. C’était aussi le plaisir de choisir un texte qui avait été très peu monté, ce qui nous laisse pas mal de champ libre finalement.
Benjamin : On a aussi l’habitude du théâtre de texte. C’est génial de s’approprier librement les mots d’un autre. Ce texte est en plus particulièrement bien écrit pour plusieurs raisons. La pièce de David Harrower est pensée pour le théâtre, c’est très intéressant pour nous de travailler une écriture faite pour la scène. C’est presque un cas d’école. Le texte est à la fois très rythmé et très ouvert. C’est du pain béni pour de jeunes comédiens. On est aussi tous les trois sensibles au conte, il y a là un sens de la fable très particulier, et qui nous parle.
Vous définissez la pièce comme un conte, comment avez-vous retranscrit cet aspect sur le plateau ?
Miléna : J’ai l’impression que le prologue y est pour beaucoup. On a inséré avant la première scène un prologue pour instaurer un rythme.
Guillaume : C’est ce qu’on appelle le « pacte des loups » entre nous. Ce prologue permet aux spectateurs d’entrer dans la matière de la pièce, il nous permet à nous comédiens de rentrer dans un rythme, un corps, une langue qui va être la nôtre pendant une heure et demie. Le conte est un type de récit qui nous coupe du rythme quotidien, qui nous met aux prises avec une époque et un lieu dont on ne sait rien. C’est pareil dans Des couteaux dans les poules, la pièce fait abstraction du lieu et de l’époque. On a véritablement cherché à sortir du concret de nos vies, à ne pas faire de récit historique ou qu’on puisse historiciser. Un conte impose des codes coupés de notre réalité. Benjamin : C’est pour cela qu’on l’appelle le « pacte des loups ». Ce prologue permet à tout le monde de se mettre d’accord sur ce qui est la normalité dans la boîte noire.
Pourtant, le spectateur a besoin de « visualiser » les différents espaces...
Benjamin : Pas forcément. Le conte permet d’épurer un maximum. On n’a pas besoin de représenter la scène de manière naturaliste, il suffit de poser des codes une première fois pour qu’ils soient acceptés par le spectateur. On signifie les lieux, on en garde l’essence. Pour le laboureur, c’est la terre, la paille. Pour le meunier, il y a des cordes parce que le travail se fait indirectement par les cordes. On veut que les gens entendent le texte avant tout. On fait confiance à leur imagination : à partir de ce qu’on propose ils peuvent se raconter ce qu’ils veulent.
Guillaume : Dans le conte, il faut imaginer une assiette coupée en deux. On représente la première partie de l’assiette et, à partir des motifs présents, les gens se représentent librement la suite. On ne représente pas dans le sens où on ne fait pas « comme si ». Sauf pour la meule.
La pièce se caractérise également par une langue très particulière, voire étrange pour le spectateur parce que peu commune. Comment avez-vous appréhendé ce texte ?
Miléna : On a choisi de biaiser un peu le sens de la pièce puisque la jeune femme trouve son propre moyen d’expression dans la musique. On a traduit ses trois monologues et la lettre de la fin de cette manière parce que dès le départ on voulait travailler avec la musique. Comme l’a dit Benjamin, la pièce est très rythmée : le rythme de la langue, le le rythme du travail aussi. C’est très musical dès le départ, très percussif. J’ai donc composé la musique à partir du texte et de ce que je lisais avant de me lancer dans la création au plateau. Le but était de trouver une cohérence, de raconter de manière cohérente l’évolution de la jeune femme. Il y a donc une progression dans la manière dont je joue du violoncelle. Il y a un transfert entre un début très percussif et une mélodie seulement composée de ma voix, et un dernier passage où la mélodie est au violoncelle et où la langue est parlée. L’expression arrive par le violoncelle, qui devient le support d’une mélodie, d’une musique.
Finalement la musique serait un langage aussi complexe que le langage des mots.
Miléna : Aussi complexe et même capable de les dépasser. Pour ma part, c’est plus intuitif. Guillaume : En soi, ce n’est pas juste cette langue musicale qui est étrange, nommer est étrange en soi. Le nom est étranger à la chose. Et pourtant on est habitués à cette manière-là de nommer par les mots. On a trouvé que la musique, parce qu’elle est moins fixe que le mot et plus structurante, englobait plus facilement le sens des choses. Un mot serait comme un filet de pêche dont les maillesseraient trop écartées pour vraiment saisir ces choses. La musique fait référence à tellement plus qu’elle resserre un peu les mailles de ce filet. Le langage musical est peut-être étranger, mais en même temps il devient plus complexe parce que plus sensitif. La musique est plus sensitive. Et du coup Miléna, en tant qu’artiste musicienne, tend à exprimer les choses de manière plus charnelle : les choses non pas par les mots, mais par des morceaux de musique.
Au bout du compte, comment passe-t-on de la création du collectif autour de cette pièce pour le festival Les Fous de la Rampe à l’université de Caen au festival Nanterre sur Scène ?
Benjamin : Le festival Les Fous de la Rampe était une très belle aventure et on avait à l’origine pensé faire juste ce festival. Après un temps, on a réalisé qu’avec Des couteaux dans les poules on avait mis le doigt sur quelque chose et qu’on n’était pas allés jusqu’au bout de la réflexion, du travail. Et puis, on a tellement aimé créer ensemble. On a donc eu envie de continuer, de se professionnaliser avec cette pièce. J’ai entendu parler du festival Nanterre sur Scène deux jours avant la clôture des candidatures, on a fait le dossier et profité d’une semaine de résidence pour préparer l’audition.
Alors quelle est la suite du collectif ?
Benjamin : On a toujours envie de travailler ensemble, mais le problème du collectif est de ne pas avoir de metteur en scène. Avec Nanterre sur Scène, on est arrivés au point où on peut enfin oublier notre statut de metteurs en scène et plonger entièrement dans le jeu de cette pièce, en profiter à fond. On n’est plus en création mais bien en besoin de représentation. Et c’est en fonction des représentations que le spectacle évoluera.
Guillaume : C’est une autre étape de travail qu’on apprend à découvrir, l’engagement n’est plus le même. En mettant de côté la mise en scène de la pièce pour ne faire plus que la jouer, cela nous laisse le champ libre pour de nouvelles idées.
Benjamin : On a tiré quelques fils à partir de cette pièce comme la thématique du conte. On a pensé à du Edward Bond, et aussi à une pièce peu connue de John Synge, Le cavalier de la mer. On a découvert notre collectif avec Des couteaux dans les poules, et on veut se tenir à la méthode de travail qu’on a développée. On veut continuer à défendre un texte et à proposer de la musique en direct.
Guillaume : Avec Des couteaux dans les poules, on a ouvert une porte et maintenant de nouvelles envies émergent. Ce qui veut dire qu’on n’a pas fini de travailler ensemble !