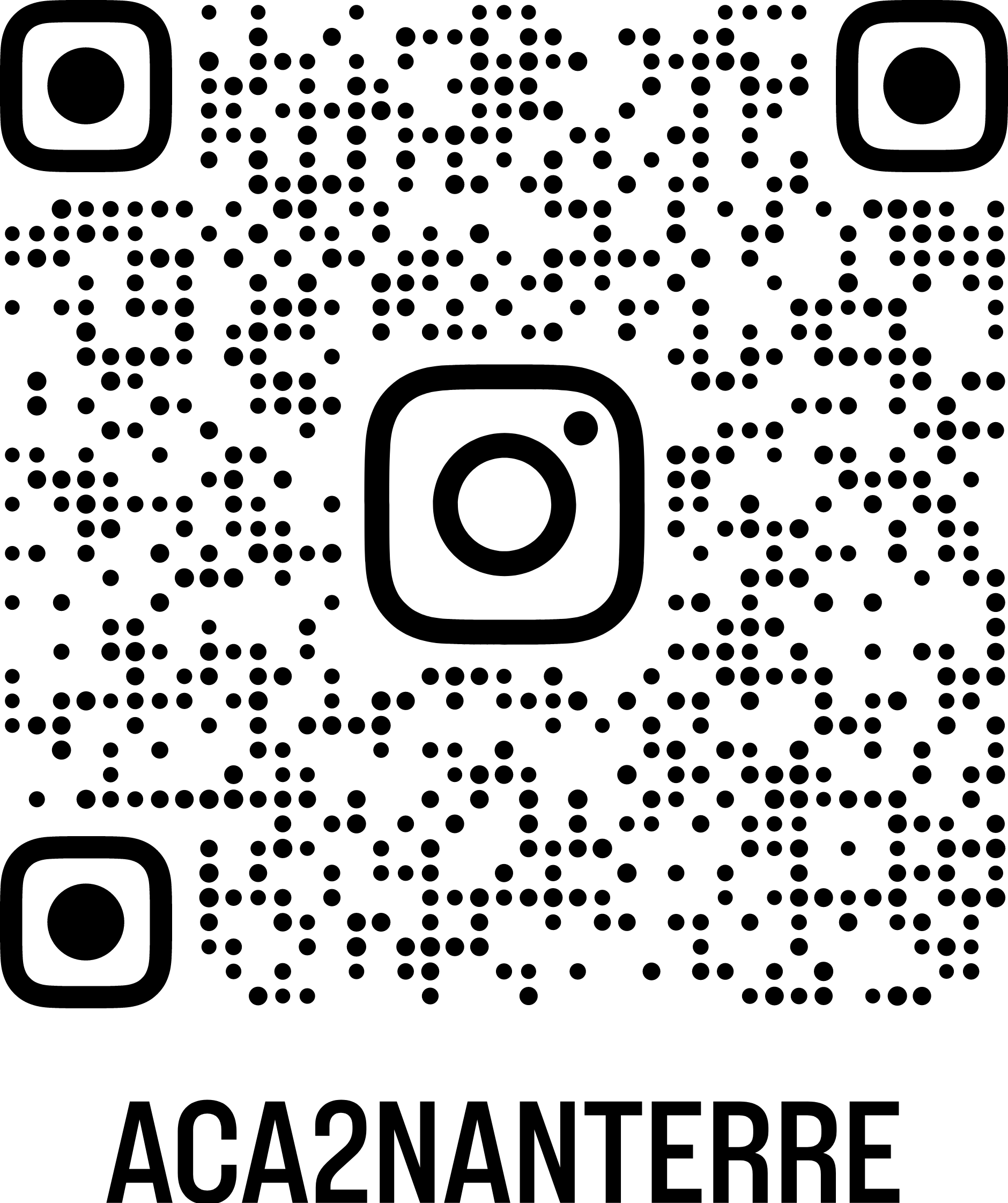Mise en scène : Eva Guland
Interprétation : Milan Boëhm, Vincent Guiot et Noémie Herubel
Création sonore : Vincent Guiot
Scénographie : Lilith Guillot-Netchine
La révolution est en marche. Milan croit qu'elle a lieu dans son ventre ; mais dans celui de Noémie, il y a un enfant. Comme le chat de Schrödinger, il est à la fois mort et vivant. Il peut décider lui-même de rester au chaud, dans le chaud de leur imaginaire à tous les deux, ou de naître, s'il est prêt à faire la révolution. Mais sans mémoire, pas de révolution. De quoi se compose le présent, si le passé est déjà passé, et le futur pas encore arrivé ? Pour décider s'ils peuvent mettre au monde un enfant, Noémie et Milan jouent à se perdre dans un labyrinthe de souvenirs. Pour trouver ce qui reste, d'une mémoire collective et de leur histoire à eux.
Entretien avec Eva Guland (Compagnie Plante un Regard, Restes) mené par Joana Durbaku, étudiante en Master 1 Humanités et Industries créatives à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
NAISSANCE D'UNE COMPAGNIE
Quel est votre parcours théâtral ?
J'ai découvert le théâtre en regardant plus qu'en lisant. J'ai fait le festival d'Avignon pour la première fois à 14 ans, et à partir de là, j'ai commencé à voir beaucoup de spectacles contemporains, particulièrement des créations collectives, des écritures au plateau. Puis j'ai fait pas mal de stages, deux conservatoires municipaux à Paris, et beaucoup d'ateliers de clown. C'est au conservatoire que je me suis soudainement découvert un goût pour la mise en scène. J'ai progressivement arrêté d'être comédienne pour plutôt diriger les comédiens. Jusque-là, je ne me voyais pas adapter des textes, mais suite à un événement dans ma vie privée, j'ai eu un déclic, un intérêt très particulier pour Cannibales, un texte de Ronan Chéneau. C'était mon premier travail en tant que metteuse en scène, je l'ai initié avec des amis dans ma dernière année au conservatoire. Je me suis prise de passion pour le travail du texte, l'assemblage de fragments, et alors j'ai réalisé qu'au-delà de la direction d'acteurs, je pouvais aussi monter mon propre projet.
Comment est née la compagnie ?
En passant le concours de l'INSAS en mise en scène, j'ai fait la rencontre de comédiens, avec qui on a décidé de lancer un laboratoire d'une semaine à Paris. C'était totalement expérimental, une expérience incroyable. Puis avec certains d'entre eux, on a donné naissance à notre première création collective, Manège. Tout partait d'une question très simple : si on met des individus dans une salle, qu'est-ce qu'il se passe ? Avec pour thème « salut, ça va ? », je voulais interroger les rapports sociaux aussi basiques qu'ils soient, jusqu'à leur déconstruction. C'est sur ce projet qu'on a officiellement créé la compagnie Plante Un Regard il y a trois ans, avec laquelle on a représenté Manège, Cannibales Remix, et L'Enquête.
RESTES
Restes est une création collective, comment avez-vous produit le texte ?
A partir d'un court texte de Noémie Herubel (comédienne avec qui j'étais au conservatoire), et de désirs personnels, nous avons voulu créer un spectacle sur la mémoire. Nous avons donc travaillé avec Milan Boëhm (comédien qui jouait dans Manège), et Vincent Guiot (avec qui j'avais déjà travaillé sur un projet principalement axé sur la musique électro-acoustique). Nous avons amorcé une recherche entre temps d'improvisations au plateau, discussions, et écriture, en décembre 2015. Depuis, les résidences se sont succédées, avec entre chacune, des échanges autour de textes, des réflexions. Nous avons beaucoup discuté d'internet, du surplus d'informations, de notre perte de repères, et de la façon dont tout se mélange. Le chantier s'est peu à peu resserré et le texte s'est construit.
Nous avons eu la chance d'être accueillis en résidence à l'Ecole Nationale d'Arts de Bourges, à la Friche Lamartine (Lyon), et au théâtre Le Hublot (accompagnement DRAC sur la saison 2015-2016).
Restes est donc le fruit d'un long temps de création, entre les sessions d'improvisation, la réflexion seule et collective sur la mémoire, le travail de Vincent sur le son, l'échange de textes entre Noémie et moi.
Quelles sont vos influences théâtrales ?
Très influencée par des collectifs et des metteurs en scène qui travaillent en écriture de plateau (Les Sans Cou, L'avantage du doute, In vitro, Joël Pommerat, Falk Richter, le TGStan, le Raoul Collectif, Les Chiens de Navarre...), je travaille sur différents niveaux de fiction, et donc différents niveaux de jeu. Les grands mouvements de la performance qui datent des années 60-70 ont probablement permis au théâtre contemporain, depuis une vingtaine d'années, de s'ouvrir vers de nouvelles formes de déconstruction des schémas narratifs. C'est en partant principalement de l'improvisation et en cherchant ce que nous avons à dire, sans se préoccuper de la notion de personnage, et sans s'enfermer dans une histoire, que je cherche une forme d'authenticité. S'il y a histoire et s'il y a personnages, ceux-là se construisent et se déconstruisent sous nos yeux. Ce sont les comédiens, tels qu'ils sont (avec leur propre prénom, et leur propre façon d'être), qui jouent à inventer rôles et fictions, à vue. Quelque part, leur recherche, comme la technique, est donnée à voir au spectateur.
Vous avez longtemps pratiqué l'art du clown, trouve-t-il un écho dans votre travail actuel ?
Ce dualisme des niveaux de jeu et de fiction rejoint une autre influence assez essentielle pour moi, le travail du clown, qui est à peu près le même que celui du travail de l'acteur dans la façon dont je dirige le jeu en cherchant à apporter un regard neuf sur les choses. Le clown vit dans le présent, il découvre tout, en permanence, on dit qu'il n'a pas de mémoire. C'est cette technique que j'essaie d'insuffler dans le travail avec les acteurs. Tout peut basculer à tout moment, on n'est pas coincé dans une fiction, un rôle, un parcours. L'identité est mouvante. Je veux appliquer la déconstruction de la fiction à la vie, et inversement.
La question de la mémoire est très liée au temps, comment le mettez-vous en ?uvre dans le cadre de la fiction ?
Je travaille effectivement sur le temps, en particulier sa déconstruction, ce n'est pas évident mais c'est mon chemin de recherche, ça me passionne. Comme on parle de mémoire, on part du principe que les souvenirs comme la pièce ne sont pas chronologiques, les images se télescopent. J'aime mettre en avant le côté interchangeable des choses, on ne sait pas qui est qui, où et quand, c'est un flou général. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de ne pas figer l'histoire, ça peut se passer partout, on donne des pistes, mais on les brouille.
Je m'intéresse particulièrement à la question de la fiction ? quelles histoires peut-on encore raconter aujourd'hui ? ? et à la question du temps, liée à la question de la mémoire, de l'incompréhension face à l'histoire qui nous a précédés, et de la difficulté d'envisager le futur.
Dans l'esthétique, j'aime chercher des processus, grâce au son, à la lumière, et au jeu des acteurs, qui nous transportent dans la déconstruction de la temporalité, voire dans l'onirisme.
LA COMPLEXITÉ D'UNE THÉMATIQUE ABSTRAITE : LA MÉMOIRE
La mémoire est une thématique particulièrement abstraite, comment l'avez-vous appréhendée dans la création de Restes ?
Notre questionnement initial était : qu'est-ce que la mémoire ? C'est d'un côté la mémoire collective, surtout occidentale, donc faussée, on retient par exemple la Résistance, mais à peine le génocide rwandais, et de l'autre côté la mémoire personnelle, subjective, en permanence inventée. Je m'y intéresse personnellement parce que je manque de mémoire, en particulier celle de mon enfance, ça m'a poussée à m'interroger sur le rapport qu'on entretient avec nos souvenirs, ce qu'on en fait, comment on les reconstruit a posteriori. Pendant nos séances de discussions avec la troupe, on essayait de comprendre le rapport entre tous ces éléments, souvent lourds, la façon dont on pouvait les mettre en lien et en scène. On a interrogé la problématique du tri : comment mettre les souvenirs dans des cases ? qu'est-ce qui est fabriqué, vrai, faux ? à moi, à toi, à nous ? le nous français, le nous humain ?
Il y a aussi dans Restes une intrigue resserrée, plus personnelle, autour des personnages de Noémie, Milan, et de l'enfant à venir. Quelle est l'articulation de la mémoire collective à la mémoire personnelle ?
Cette tentative de tri de la mémoire collective a été un échec pendant la création, impossible à représenter. Alors on a resserré l'intrigue jusqu'à une dimension plus personnelle, pour raconter une histoire plutôt que de se perdre dans l'immensité de la mémoire collective. L'idée initiale d'une entreprise de stockage de données est restée, mais c'est avant tout la question d'un enfant à naître qui articule la pièce.
De l'imbrication de mille histoires est née une histoire, celle de Noémie, qui a peut-être un enfant dans son ventre. Est-ce que l'enfant est là ? Est-ce qu'il va décider de sortir et de faire la révolution ? Cette tension est au c ?ur du spectacle. L'enfant à venir représente la possibilité ou l'impossibilité de la continuité de l'histoire personnelle et de l'histoire collective.
Durant une pause dans l'écriture dramaturgique cet été, je me suis profondément questionnée sur le désir d'enfant. Au-delà des interrogations pragmatiques, matérielles, politiques, la question que je me suis posée, que l'on retrouve au c ?ur de la pièce est : que va-t-on dire à l'enfant qui va naître ? que vais-je lui dire ? que peut-on transmettre ? qu'a-t-on à raconter ?
Noémie dans Restes dit que l'enfant ne doit naître que s'il doit sortir pour faire la révolution, sinon, ça n'en vaut pas la peine. Pour projeter une construction mémorielle future, apparaît la nécessité de transcender une mémoire dévastée. La possibilité de la naissance est liée à la nécessité de la transformation du monde, à la nécessité révolutionnaire.
Si notre génération anesthésiée n'arrive pas à faire la révolution, est-ce que la suivante, elle, aura la possibilité d'agir ?
Le titre, Restes, s'offre à plusieurs interprétations, parfois ambiguës. Que signifie-t-il pour vous ?
C'est là l'ironie, que va-t-il rester de quoi ? On aurait pu l'appeler Mémoire, mais la mémoire est partielle, alors on a nommé la pièce Restes. On a hésité à mettre le ?s entre parenthèses, ça créait un impératif, « reste », comme une injonction lancée à l'enfant dans le ventre de Noémie, le refus de sa naissance. Puis finalement la mémoire, ce ne sont que des restes, pas forcément cohérents, comme la vie, et comme ce qu'il restera de notre mémoire dans l'enfant né, ou décédé.
UNE DRAMATURGIE DU CHAOS
Une certaine violence se dégage de la pièce. Qu'est-ce-qui vous a poussé à en faire un matériau théâtral, finalement essentiel ?
On vit dans un monde ultra-violent, la violence est omniprésente, donc forcément on travaille avec, d'où aussi le recours à un musicien noise. J'essaie quand même d'insérer un peu de douceur et d'espoir, mais même dans ces scènes-là, la violence est inévitable. Ce qui est violent, ce n'est pas le fait d'avorter, mais la vraie violence est dans la culpabilisation exercée par une société dans laquelle la place de la femme reste très liée à la maternité. C'est avant tout notre monde qui donne à voir la violence, alors qu'on ne dise pas d'une pièce de théâtre qu'elle est violente, même si elle est peut-être cathartique.
Vous ne faites donc pas du théâtre de divertissement. Il y a peut-être alors une critique sociale qui en émerge. Comment appréhendez-vous la réception par le public ?
On ne fait pas un travail consensuel, mais c'est tant mieux. Bien sûr, on aimerait que ça parle au plus de gens possible, mais s'il reste quelque chose chez le spectateur, c'est déjà bien. Si on peut susciter un peu de réflexion et d'émotion, c'est encore mieux. Après, le public adhère, ou pas. C'est quitte ou double. Je ne pense pas qu'on sorte de cette pièce en se disant simplement que c'était un bon moment. Je ne cherche pas à produire une critique ou un jugement, c'est surtout un miroir, une vision du monde à un moment donné, pour moi. Le regard porté peut être critique, parfois, mais c'est d'abord pour trouver ce que je peux dire, justement, sur ce monde-là. Je cherche à créer les conditions pour faire surgir ce que j'ai, ce que nous avons vraiment à dire, de façon presque inconsciente. Nous racontons une histoire qui se nourrit de nos maladresses à raconter, à maintenir l'illusion bancale d'une fiction. Par superposition des couches, une dramaturgie du chaos émerge.
La pièce est une succession de versions différentes de la possibilité de la naissance de l'enfant. Alors il n'y a pas de message clair, j'essaie de laisser de l'espace pour que chacun comprenne ce qu'il a besoin de comprendre, il y a autant d'interprétations possibles que de spectateurs, je n'en impose aucune.
Dans quel registre situez-vous votre création ?
J'oscille entre deux esthétiques, de la violence à une légèreté soudaine. Le spectacle est assez cinématographique, souvent angoissant. On joue aussi beaucoup sur l'autodérision. C'est de l'absurde, sur un fond de violence cynique.
J'essaie de travailler au maximum avec toutes les émotions. Pour moi le moment de justesse, c'est celui où j'ai envie de rire et de pleurer en même temps. Ce serait prétentieux de dire que j'y arrive, mais c'est mon ambition. D'ailleurs, on me dit souvent qu'on me voit sur scène, il y a effectivement une dimension très personnelle. Je suis toujours émerveillée par la vie, en prise à des émotions extrêmes et opposées.
Peut-on dire qu'il s'agisse d'une insurrection sur scène, d'une quête de transe sur le plateau ?
C'est très juste. Je pense que mon travail de fond en tant que metteuse en scène c'est d'insuffler une certaine énergie. J'ai pris l'acteur comme point de départ, en me demandant comment le diriger. Pour moi, c'est quelque chose de très organique, une question de présence corporelle et de relations en cours de construction. Je suis sur le plateau avec eux, je me balade, je leur tourne autour et souffle des indications et des objectifs, j'appelle ça « l'oreillette ». On fait des trainings ensemble, on a essayé la méditation active sur une session de travail du monologue de Milan. On joue ensemble, dans un état de corps, on cherche ce quelque chose qui transcende. C'est de cette façon qu'on arrive à la naissance de l'étrange : c'est drôle, violent, neuf, fort. C'est comme dans la vie, ce qu'il se passe, mais si on n'est pas toujours comme ça, dans la vie, c'est parce que la société nous l'interdit, on est anesthésiés !
UNE ESTHÉTIQUE MÉTAPHORIQUE
Que symbolise la scénographie de Restes, qui est, contrairement au texte et au jeu, plutôt minimaliste ?
Lilith Guillot-Netchine la scénographe, à l'origine plasticienne, m'a proposé le système des boîtes de tri, pour stocker comme le cloud le surplus d'informations, puis le fil qui relie le son et monte au plafond, créant une structure métallique, les trois fils du passage du temps dans son infinité, sans début ni fin, et enfin un micro suspendu au milieu, pour signifier que tout est enregistré, surveillé, rediffusé, en permanence. Ce sont des symboliques très fortes, dans un tout clair et cohérent.
Résultat : on réalise après coup que cette esthétique scénographique contraste complètement avec mon travail et le chaos que j'insuffle à mes acteurs. Je n'avais pas demandé à ce qu'elle crée l'inverse pour contrecarrer, mais ça m'est bénéfique parce que ça me permet d'exprimer plus de choses. La scénographie carrée me rappelle à l'ordre, et me permet donc beaucoup de débordement, puisqu'il y a un cadre très précis.
Le son, orchestré par les machines de Vincent Guiot, semble avoir un véritable rôle dans la pièce. Comment se met-il en scène ?
Vincent travaille sur le bruit, le silence, le chaos. Dans la pièce, c'est un acteur-performeur, créateur à part entière. Son travail est très autonome, moins dirigé. Il a une bonne partition de texte, fait des commentaires, travaille sa voix au micro, recadre la situation, nous manipule et nous perd en traitant le son en direct avec des effets, échos, boucles et réverbération. Sa présence est nécessaire, on ne fait pas de répétitions sans lui.
Quelle est la place du corps, dans le monde futuriste et mécanisé de Restes ?
Il n'y a pas à proprement parler de costumes dans Restes, les comédiens sont simplement vêtus de noir. C'est une transe corporelle, une force vitale. Noémie et Milan ont une forte gestuelle. En revanche, Vincent est figé sur ses machines, enfermé dans son corps, il se demande s'il doit rester, ou sortir de son rôle. Ça crée une tension. Le travail sur le corps est central dès le travail d'écriture, la recherche d'un état de corps permet de trouver une justesse, de faire éclater une vérité : « les corps parlent », c'est du spectacle vivant.
LA MÉMOIRE, ENTRE ESPOIR ET FATALITÉ
La mémoire est une thématique atemporelle. L'avez-vous néanmoins abordée dans sa relation à l'actualité, aux événements politiques contemporains ?
Ça ne peut qu'être actuel. Dans le texte, Noémie parle des valeurs de la République, des événements depuis Charlie. On pointe en quelque sorte la mémoire collective, on interroge de qui a été retenu de façon consensuelle par les médias. Alors la pièce n'est pas explicitement politique, mais ces dimensions sont forcément là.
Notre travail parle de notre génération, on ne se reconnaît plus dans aucun système. C'est aussi la question de la révolution par l'enfant dans la pièce. Notre génération perdue et désabusée, qui ne croit plus en rien, peut-elle encore faire la révolution ?
La possibilité d'une révolution finale porte-t-elle l'espoir d'un futur nouveau ?
Le monologue final a beaucoup été réécrit, je ne savais pas très bien où me situer par rapport à la question de l'espoir à donner ou non, et à quelle dose. Je ne sais pas comment cette histoire se termine, je ne veux pas l'enfermer, la conclure. Donc je ne veux pas spécialement donner d'espoir, ni le confisquer.
S'il doit y avoir un espace pour l'espoir, il est dans le fait même d'être là, vivant, sur scène, et de se laisser dépasser par ce que nous pouvons encore avoir à raconter.