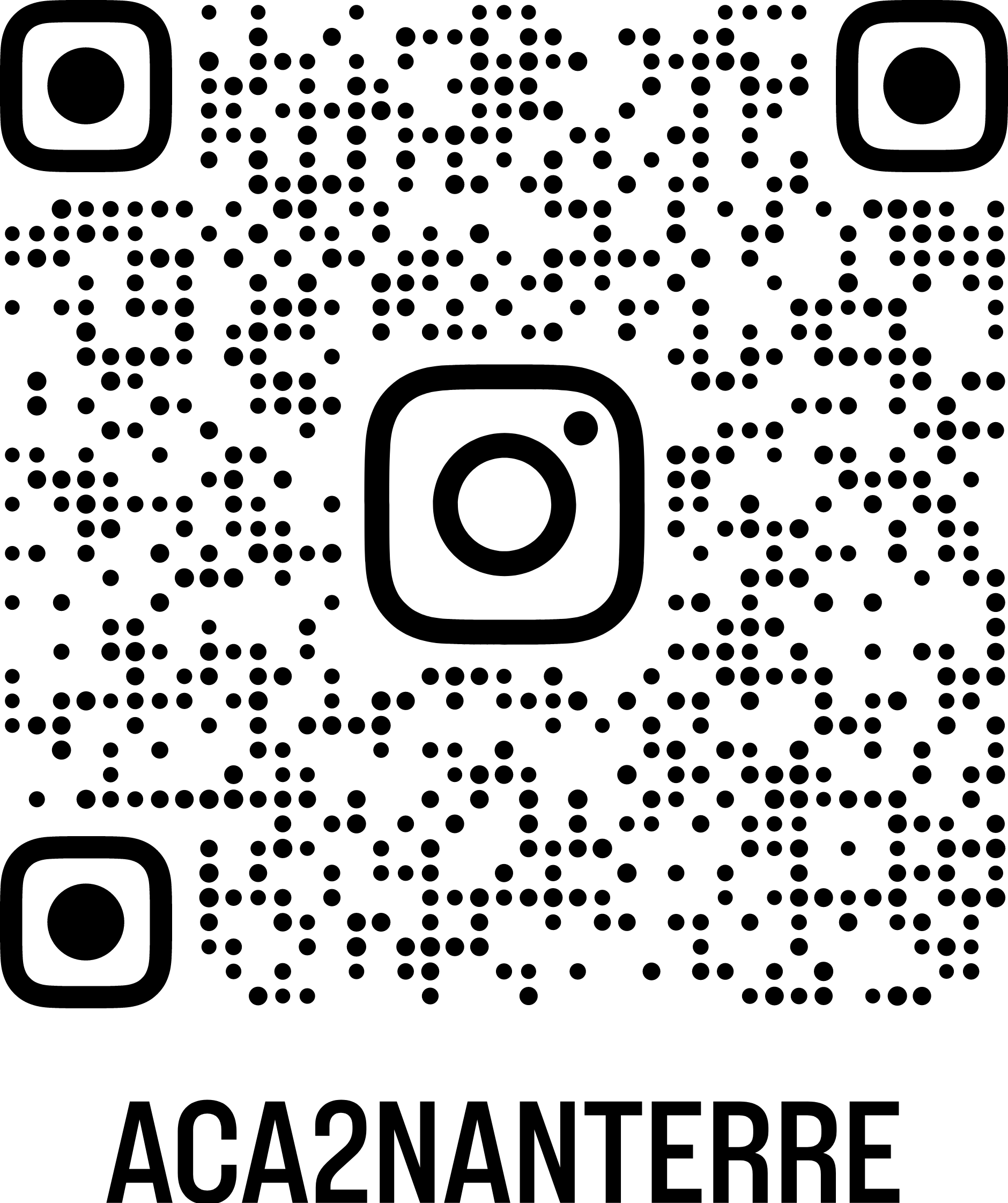Robin Cauche et Charles Dunnet
Mise en scène : Pauline Rousseau
Interprétation : Marie Astier, Thomas Bouyou, Ulysse Caillon, Charles Dunnet, Millie Duyé, Pauline Rousseau et Paul-Antoine Veillon.
Dramaturgie : Ulysse Caillon
Back in the ’80s.
Entre la France et les États-Unis, des hommes vont mourir du sida.
Ils attendent, ils espèrent, ils se mentent.
Ils luttent, contre le virus, contre l’indifférence politique, contre eux-mêmes.
Mai 1981 : Election de Mitterrand. L’homosexualité « dépénalisée ».
Juin 1981 : 1ers cas de sida identifiés à Los Angeles.
1996 : Arrivée de la trithérapie.
Quinze années noires emplies de morts, de deuils, mais aussi de luttes et d’espoirs.
Raviver cette mémoire, du récit individuel à la lutte collective, et combattre l’oubli. « Sidaïques », « pédés », « putes », « drogués » : qu’est-ce que ces Autres nous racontent aujourd’hui ?
« Silence = Mort ! Action = Vie ! ». VI(e)H.
Entretien mené par Jeanne Jézéquel, étudiante en Master 1 Humanités et Industries créatives à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Pouvez-vous présenter les deux compagnies : La compagnie en carton et Totem Récidive ?
Marie Astier : La compagnie en carton a été créée en 2013. Nous défendons un théâtre “pauvre”, on ne se permet aucun débordement scénographique, car de toute façon on n’en a pas les moyens ! Ça en devient un véritable parti-pris esthétique. Depuis le spectacle Hosto en 2015, mon but est de creuser les liens entre théâtre et maladie, théâtre et vulnérabilité, au croisement de l’intime et du social.
Pauline Rousseau : TOTEM Récidive a été créée en 2013 par Thomas Bouyou, Loris Reynaert, Laurie Soulabaille et Christine Tzerkezos-Guérin. La compagnie travaille principalement sur les écritures contemporaines, à des projets mêlant l’intime et le politique sur des questions d’actualité comme les thématiques de genre (Partout sauf par terre).Le projet VI(e)H réunit donc une équipe hybride, des comédien.ne.s issu.e.s de deux compagnies et d’autres personnes. Au départ, on s’est tous rencontrés grâce à Marie Astier et Ulysse Caillon, il y a environ un an. L’idée était de proposer une forme théâtrale suite à un colloque sur la thématique du VIH à l’ENS Ulm. Le colloque a été compliqué à organiser et le projet a progressivement pris son indépendance. Nous avons déjà joué le spectacle deux fois en avril 2016. Suite aux retours du public et à un changement d’équipe, nous avons décidé de le reprendre intégralement.
De qui est composée l’équipe de ce spectacle ?
Pauline Rousseau : Nous sommes sept, c’est une création collective. Nous avons, avec Marie Astier, Ulysse Caillon et Millie Duyé, travaillé sur la dramaturgie en sélectionnant des textes que nous avons proposés aux comédiens, sans pour autant les leur imposer ! Le premier montage, à la suite du colloque, a été modifié de façon à davantage insérer la dimension politique. Aujourd’hui, je me concentre plus sur la scénographie et les lumières. Nous jouons tous dans la pièce, ce qui permet d’avoir plusieurs possibilités de regards extérieurs. Désormais, on ne veut plus seulement restituer la parole mais faire de ce spectacle quelque chose qui nous appartient. On s’approprie davantage le sujet et les textes canoniques comme ceux de Guibert ou Lagarce par exemple. L’idée est de croiser les enjeux politiques, sociaux et intimes, plutôt que de réaliser un hommage littéraire.
En quoi l’élaboration de ce spectacle est-il un véritable travail d’équipe ?
Marie Astier : Le groupe est particulièrement à l’écoute et bienveillant, on ose tous faire des propositions, on n’a pas peur d’aller au plateau en se trompant, il n’y a pas d’autocensure. On propose tous des choses et le groupe réagit, c’est ainsi que l’on construit ensemble.
Pauline Rousseau : Reprenant le concept de Jean-Pierre Sarrazac, Ulysse Caillon a parlé de “théâtre rhapsodique” : l’idée du rhapsode est de créer une histoire en procédant par un montage de textes. Nous nous sommes appuyés sur un matériau très divers, des romans, des pièces mais aussi des ouvrages critiques, historiques et sociologiques sur la question du VIH/SIDA. Nous lisons tous beaucoup de notre côté et nous travaillons à dégager les enjeux principaux, puis nous travaillons beaucoup à partir d’improvisations et de là se mettent en place les scènes. Ce spectacle nous touche chacun et chacune personnellement, nous formons une équipe mixte : gays, lesbiennes, hétéros, et nous n’avons pas tous la même approche du sujet. Nous voulons partager avec le public ce qu’on a découvert, et surtout montrer que chacun a travaillé à partir de son rapport personnel au sujet.
Marie Astier : Notre travail est le fruit de cette réflexion, nous avons aussi dû abandonner pas mal de choses et nous résoudre à « ne pas parler de tout », c’était peut-être le plus difficile. Mais nous faisons confiance au public pour continuer le travail de recherche et le débat que suscitent cette maladie et son histoire. L’idéal, ce serait d’amener les spectateurs dans un débat avec eux-mêmes, ou avec les autres spectateurs, et de leur donner l’envie d’aller d’eux- mêmes chercher plus loin dans les sources qu’on a pu mobiliser.
Pauline Rousseau : Le projet nous a permis de faire de nouvelles rencontres. J’ai été invitée à une émission sur France Culture où j’ai pu découvrir le travail de Daniel Arsand, un auteur- romancier qui a écrit notamment le livre Je suis en vie et tu ne m’entends pas. Ce roman porte sur la question des homosexuels déportés pendant la seconde Guerre mondiale et se termine pendant les années sida. Nous allons utiliser des extraits de son roman car c’est un travail qui m’a beaucoup intéressée.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de réaliser un spectacle sur la maladie ?
Marie Astier : Les liens entre théâtre et maladie m’intéressent mais je ne suis pas du tout spécialiste de la question du sida, c’est pourquoi j’ai contacté Ulysse Caillon qui avait fait son mémoire notamment sur Jean-Luc Lagarce, qui a ensuite lui-même fait appel à Pauline, qui serait plus en mesure de travailler la mise en scène
Pauline Rousseau : Ma thèse porte sur le théâtre des minorités sexuelles ; je suis d’ailleurs en train de recentrer mon sujet sur les autoreprésentations des minorités sexuelles par rapport au sida, une thématique qui m’avait toujours beaucoup intéressée pour des raisons personnelles et des convictions politiques. Tous les comédiens de la troupe sont nés vers la fin des années 80 ou début des années 90, on a donc beaucoup entendu parler du sida à travers les sessions de prévention. Quand nous avons commencé le projet, nous nous sommes rendu compte que ce qu’on en avait gardé était principalement ce que l’école nous avait transmis, c’est-à-dire quelques chiffres et une vision très scientifique des moyens de prévention. Nous avons voulu nous plonger dans l’histoire vécue, intime, de la maladie et plus généralement l’histoire politique, médiatique et médicale de ce qu’on a appelé les « années sida ». Une période récente (1981 – 1996) qui constitue une période-clé de l’histoire politique, à la fois pour les minorités sexuelles – la communauté LGBT – mais aussi pour l’ensemble de la population.
Ce projet nous permet d’interroger plus généralement le rapport à l’autre et à l’exclusion. Le VIH a été un facteur de désignation de l’autre comme différent, dangereux et potentiellement viral. Il est important de retracer cette histoire aujourd’hui car elle est récente et, d’après nous, plus que jamais d’actualité. (Cela n’était pas paru au moment de l’entretien mais comme tu le sais sûrement, les maires d’Aulnay-sous-bois et d’Angers, ainsi qu’une dizaine de villes de France ont décidé de censurer la campagne de prévention sur le VIH au motif qu’on voyait deux hommes s’embrasser... Ce genre de réactions nous font dire que le combat n’est jamais gagné et que nous sommes plutôt dans une période de retour de la répression et de « l’ordre Moral » contre lequel il va falloir agir !)
De quelle manière vous êtes-vous renseignés sur le sida ? Quels sont les textes et auteurs que vous avez repris ou dont vous vous êtes inspirés ?
Pauline Rousseau : Nous avons beaucoup lu, des romans, des pièces de théâtre, et des articles de presse. Nous connaissions un peu tous Jean-Luc Lagarce, nous avons étudié Hervé Guibert (A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Le protocole compassionnel), mais aussi des textes anglo-saxons comme Angels in America de Tony Kushner, que nous ne pourrons malheureusement pas reprendre car nous n’avons pas obtenu les droits. Nous avons aussi utilisé The normal Heart de Larry Kramer, ainsi que des sources cinématographiques intéressantes pour se rendre compte de l’effet de la maladie sur le corps. Ce n’est pas la même chose de lire une description et de voir l’effet à l’écran. Guibert a réalisé le film La pudeur ou l’impudeur, quelques mois avant sa mort. Nous avons regardé des films documentaires comme des films de fiction, cela nous a aidé à faire des choix par rapport aux différentes façons de représenter le sida. Dans la presse il y a eu beaucoup de choses autour du sida, notamment dans la presse gay comme Gai Pied ou dans la revue Masques, mais aussi dans la presse « mainstream » comme Libération ou Le Nouvel Obs. Nous avons aussi regardé dans les archives INA, notamment la tristement célèbre interview de Jean-Marie Le Pen en 1987 sur Antenne 2, dans laquelle il parle des “sidaïques”. Les chroniques de Didier Lestrade, fondateur d’Act Up, dans le Journal du Sida, ainsi que les études plus sociologiques de Michael Pollak dans Les homosexuels et le sida sont très intéressantes. La bibliographie est longue, il faut faire attention à ne pas créer une nouvelle scène pour chaque nouvelle idée. Énormément de problématiques se mêlent, un des enjeux pour nous est de renoncer à vouloir tout dire. Ce n’est pas envisageable sur une thématique aussi vaste et complexe. Pourtant on se permet beaucoup de choses : des coupes, des passages de l’indirect au direct afin d’engager des dialogues. Nous essayons aussi de créer des moments plus chorégraphiques en transcrivant l’écriture dans le corps. Nous avons écrit certains passages nous-mêmes, notamment une scène de rencontre entre l’un des premiers militants de la lutte contre le sida au sein de la communauté gay et l’une des premières médecins qui s’est attachée à la recherche sur le sida. Il ne faut pas oublier que la communauté gay a fait de la libération sexuelle un vrai principe politique.
Avez-vous un message à faire passer au public, et en particulier aux jeunes ?
Marie Astier : Nous sommes au croisement de quelque chose de très intéressant et de multigénérationnel. Les personnes qui ont vécu ces années trouvent ça beau, courageux et intéressant qu’on ose rappeler cette période, tandis que les gens qui ont plutôt notre âge, les jeunes qui ne s’y intéressent pas forcément, découvrent cette histoire. Certains la revivent et l’interprètent comme un hommage, d’autres la découvrent.
Pauline Rousseau : On s’adresse aux jeunes en tant que jeunes qui nous sommes emparés de cette histoire-là. Nous avons nous-mêmes été surpris par toutes les choses que nous avons découvertes. Nous avions l’idée que nous connaissions le sida, par les sessions de prévention, mais toute cette histoire, tous ces textes, toutes ces personnes qui sont mortes nous restaient inconnus. Nous avons la volonté de partager cette histoire avec les jeunes, mais aussi d’alerter, car aujourd’hui il y a une recrudescence de la contamination par le virus, sûrement parce que les gens se sentent plus protégés. Notre pièce s’adresse à tout le monde car elle aborde la question de la “libération sexuelle”, et donc de la sexualité comme espace politique. Nous voulons retrouver cette mémoire et la faire vivre. Cela s’adresse aussi, comme dit Matthieu Lindon dans son livre Ce qu’aimer veut dire, aux victimes secondaires de cette période : celles et ceux qui ont survécu.
Marie Astier : On s’adresse à tout le monde dans le sens où nous ne faisons pas une représentation scientifique du sida, nous montrons comment cette maladie s’inscrit dans des histoires intimes et implique des répercussions politiques. Cette pièce touche chacun.e différemment, évidemment pour les membres de la communauté LGBT qui ont vécu cette période, c’est particulièrement émouvant. Pour celles et ceux qui ne l’ont pas vécu – ou pas d’aussi près – c’est un espace de réflexion et de découverte sur ce qui reste « la plus grande épidémie virale jamais connue ».
Considérez-vous ce spectacle comme du théâtre engagé ?
Pauline Rousseau : Complètement. Pour moi, il y a là un positionnement politique très clair. C’est un spectacle engagé politiquement mais aussi dans des partis-pris esthétiques. A travers ces auteurs et ces personnages, on réfléchit sur l’actualité, la stigmatisation, le fait de désigner l’autre comme un danger. Ce spectacle s’inscrit contre les politiques d’aujourd’hui – à mon sens délétères, que ce soit à droite comme à gauche.
Marie Astier : Nous sommes vraiment au croisement entre la France et les Etats-Unis. En France, le théâtre engagé et militant – surtout communautaire – peut être mal vu, alors qu’aux Etats-Unis c’est moins le cas. On assume notre engagement car le fait d’être au croisement du politique, du social et de l’intime crée esthétiquement de très belles choses sur le plateau, et fait dialoguer les espaces et les textes. L’engagement est source de création théâtrale, on revendique cette étiquette car elle nourrit la création.
Comment utiliser le comique sur un sujet comme celui-ci ?
Marie Astier : Le comique est primordial dans la construction de la pièce. On travaille une forme d’autodérision. Lagarce parlait de “l’humour gay”, comme forme littéraire, qui passe par la capacité à rire de la situations qui ne sont pas drôles en soi ; c’est un humour du détournement. Nous utilisons aussi le comique pour rappeler que ces personnes-là ont ri aussi. Nous avons travaillé sur le corps en fête et le corps malade, deux polarités qui sont, dans cette maladie, complètement imbriquées l’une dans l’autre.
Pauline Rousseau : L’humour et la joie étaient aux fondements de la révolution sexuelle. Il faut le montrer pour sortir d’une représentation misérabiliste, pour éviter d’être uniquement dans la tristesse. Les mouvements gays prônaient non seulement la fierté, mais aussi la joie d’être homosexuels et plus généralement des formes d’amours libérées de certains carcans. Nous ne pouvons rester dans une dynamique de deuil par rapport à cette période car elle a aussi donné de formidables moments de lutte dans le désespoir parfois mais aussi la rage et la joie. Act’up et Les sœurs de la perpétuelle indulgence nous ont beaucoup inspiré.
Un même personnage peut être joué par différents acteurs ou actrices au cours de la pièce, pourquoi cette circulation des rôles ?
Pauline Rousseau : Au début c'était plus une question purement pratique. Ce qui était intéressant c'était ce parti-pris que les hommes ne jouent pas nécessairement des hommes et des femmes, des femmes. En tant qu’acteur ou actrice, on peut s’emparer de tous les rôles et de toutes les paroles.
Marie Astier : Ça donne aussi l’idée que le VIH peut tomber sur n’importe qui, ce n’est pas associé à un personnage en particulier. Faire circuler la parole dans la pièce permet de le montrer. Ce système casse aussi la hiérarchie entre premier rôle, second rôle, etc. L’aspect communautaire se retrouve à travers ce principe dramaturgique. Hervé Guibert parlait du sida comme de “cette maladie qui nous liait déjà tous”. Maintenant nous sommes plus concentrés sur une mise en scène chronologique, car cela aide le spectateur à comprendre l’histoire de la maladie dans une communauté, et non de personnages en particulier, comme il en était question dans la première version du spectacle.
Pauline Rousseau : C’est une chronologie en trois parties : la première présente les premiers cas de sida identifiés à partir de 1981, ensuite entre 1986 et 1991 nous avons voulu montrer l’emballement politique et médiatique. Nous avons articulé des textes de différents médias, d’hommes et femmes politiques qui se sont exprimés sur le sujet, le tout clôturé par l’intervention de Jean-Marie Le Pen. La troisième partie, de 1991 à 1996, relate les nombreuses morts et la lutte politique, en particulier des associations Act Up. Nous avons changé de paradigme depuis les premières représentations du mois d’avril car cette mise en scène correspond mieux à la réalité que nous voulions présenter.
Pourquoi VI(e)H ?
Marie Astier : Nous avons voulu montrer comment réinscrire cette maladie dans l’histoire de la vie d’une communauté. Ce titre s’inspire du slogan d’Act Up : “Silence = death”. Pour nous, en parler représente donc la vie. Nous sommes conscients d’avoir un discours très européen, mais on garde à la fin une ouverture sur le reste du monde. On assume complètement le fait de parler depuis une posture particulière car en peu de temps nous ne pouvons pas parler du VIH à travers le monde et les époques.
Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Marie Astier : Ce ne sera jamais le même spectacle en fonction de la date et du lieu où l’on joue. C’est une réflexion qui est toujours en évolution et il semble impossible de la figer. Evidemment, l’objectif est de tourner le plus possible mais aussi de confronter le projet à des publics très divers (communautaire, scolaire, festival de jeunes – ou moins jeunes – créations...). Pour le moment, VI(e)H est programmé au festival Traits d’union les 21 et 22 janvier au Théâtre du Duende à Ivry, puis nous espérons courant février au Festival des Cultures LGBT et encore bien d’autres dates...
Pauline Rousseau : Nous ne sommes pas dans la dynamique “Notre montage est terminé, on n’ajoute rien”. Si nous trouvons un passage de texte qui nous intéresse, qui semble riche, nous lui trouverons forcément une place. Je pense que ce projet ne sera jamais terminé. Nous avons envie de le produire dans toute la France.