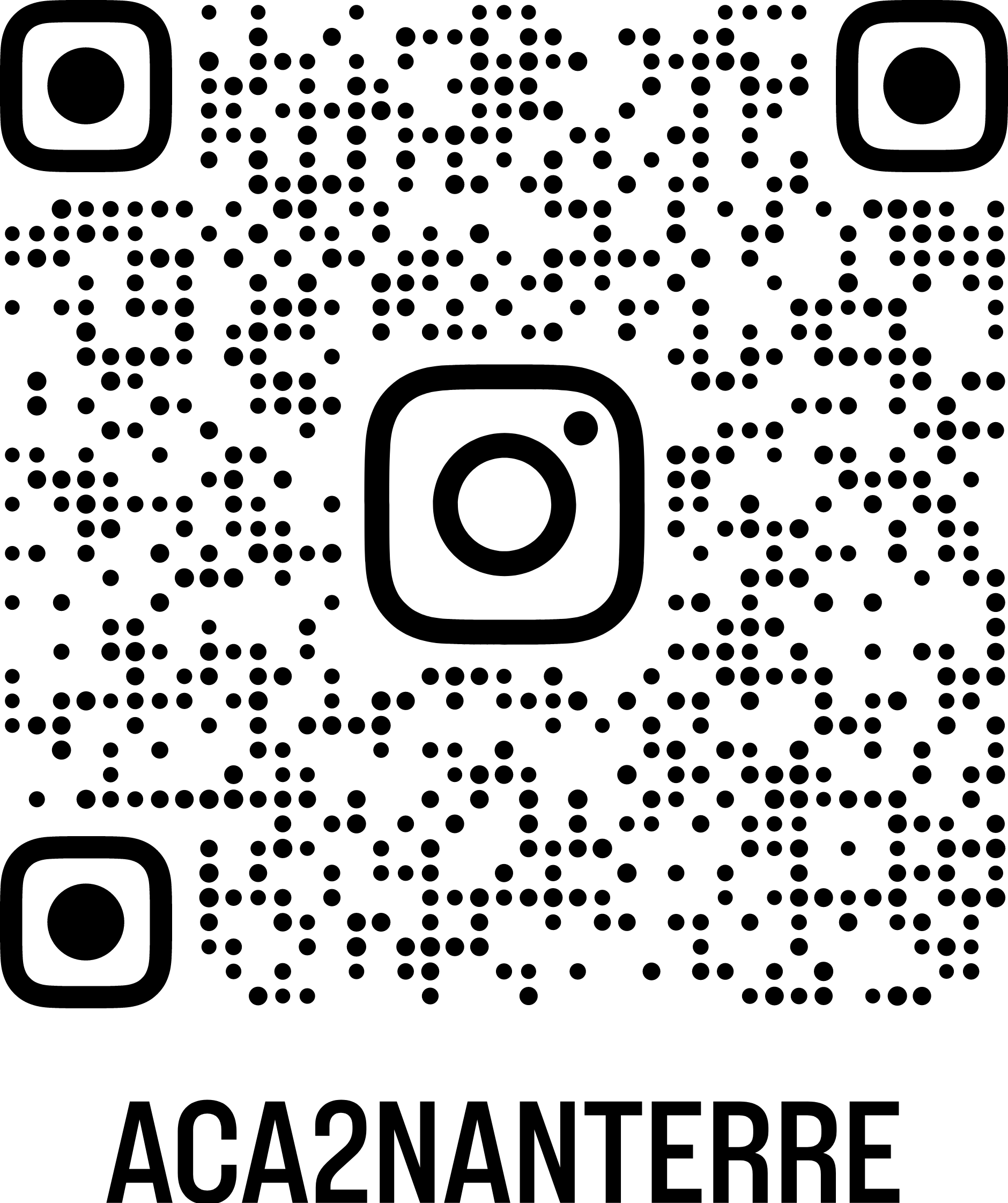Samuel Guillaud-Lucet
Mise en scène : collective
Avec : Guillaume Cardineau, Delhia Dufils, Rebecca Fels, Benjamin Fouchard, Joe Hébert et Loeiz Perreux
Création et régie lumière : Delhia Dufils
Création musicale : Thomas Pineau
Création vidéo : Samuel Guillaud-Lucet
– Mais on était d’accord, on a voté -
– Eh bien ça sert à quelque chose de voter tiens.
– Je n’ai jamais voté moi, jamais voté !
– Tu n’étais pas là quand on a voté –
– On n'a qu’à voter pour savoir si on doit voter !
– C’est complètement con –
– C’est simple, c’est démocratique, c'est...
George Kaplan - ou le groupe, si vous préférez, le Groupe George Kaplan - c'est l'histoire d'un groupe d'activistes – puisque George Kaplan n'est ni plus ni moins qu'un petit groupe d'activistes - réuni ce soir pour tourner une vidéo de propagande – un canular - une fausse piste - enfin pas complétement – puisque, quitte à ce que ce soit réaliste, autant dire des choses sensées, des choses qui nous tiennent à cœur, ça rendra cette piste d'autant plus crédible.
Entretien
En choisissant de mettre en scène le GGK, première partie de la pièce George Kaplan de Frederic Sonntag, le collectif éponyme entend créer la discussion. Autour d’un café dans le quartier de Beaubourg, nous rencontrons Nathan et Benjamin : le premier est un ancien membre du GGK, le second est arrivé récemment dans le groupe. Ils nous font part de leurs réflexions sur ce texte et sur ses liens avec la société actuelle.
Comment vous-êtes vous rencontrés ?
Nathan : Au départ c’est l’idée de trois étudiantes qui souhaitaient créer un projet en commun. Nous nous connaissions tous même si nous venions d’endroits différents, par exemple du conservatoire mais aussi de la formation Arts du Spectacle de l’Université de Caen.
Benjamin : Ils ont monté George Kaplan pour le festival « les Fous de la Rampe », un festival de théâtre étudiant qui a lieu chaque année à Caen. Un concours y est organisé avec une tournée à la clef. Ils ont gagné, mais la tournée s’est déroulée juste après les auditions pour Nanterre. Entre ces deux moments, les auditions pour les écoles de théâtre ont eu lieu et plusieurs membres du collectif ont dû partir. Ainsi moi et deux autres nouveaux acteurs, nous avons repris leurs rôles respectifs.
De quoi parle la pièce ?
Nathan : La pièce parle du Groupe George Kaplan. Il s’agit d’activistes qui sont décidés à mener une action : la captation vidéo de leur message politique. Mais l’action qu’ils ont envisagée ne fonctionne pas ; on assiste alors à leurs questionnements, sur les mots à employer, sur l’action en elle-même, sur leurs remises en question.
Qu’est ce qui vous a intéressés dans la pièce ?
Nathan : Nous sommes partis sur plusieurs pistes différentes, puis nous avons fait une lecture de George Kaplan. Nous y avons retrouvé des questions que nous connaissions en tant que groupe : la question de l’identité, celle de l’effacement de soi au profit du groupe sont centrales. Mais aussi toute une réflexion sur la politique à l’heure actuelle et sur le théâtre, la forme que l’on peut lui donner : cela faisait par exemple écho aux Nuits Debout auxquelles quelques-uns d’entre nous avions assisté.
Benjamin : Du point de vue du jeu, j’ai été marqué par le travail sur le réel qu’a suscité pour nous ce texte. Nous jouons « pour de vrai », sans chercher à effectuer un travail sur le langage. Ce qui est tout à fait l’inverse de ma formation au conservatoire, ainsi que celle de Nathan, qui est très portée sur la technique et la maitrise du langage.
Avez-vous observé des similitudes entre le texte et votre collectif ?
Benjamin : Les parallélismes entre notre collectif et la pièce sont forts. Il n’est pas anodin que le collectif s’appelle GGK, nous voulons nous amuser à rendre aussi floues que possible les limites entre le théâtre et la réalité. Il arrive même parfois sur le plateau que nous ne sachions plus vraiment si nous sommes en train de jouer ou si nous nous disputons vraiment.
Nathan : La place du groupe en tant que collectif appuie cette idée. Ce qui arrive sur scène, les débats, les remises en question, tout cela nous est déjà arrivé. Chacun crée son rôle en y mettant de lui-même, et nous réfléchissons constamment sur notre travail. Au bout du compte nous agissons dans notre collectif comme le Groupe George Kaplan dans la pièce, en insistant sur la prise de parole et en nous organisant autour de cela.
Comment se construit ce projet, en tant que collectif ?
Nathan : Nous nous sommes rapidement distribué les rôles, tout en les échangeant parfois pour avoir des idées de jeu différentes. Nous avons aussi beaucoup parlé de la pièce et du collectif dans les bars, des discussions annexes qui ont parfois alimenté notre travail. Le passage au plateau s’est fait par l’improvisation, et comme nous étions toujours ensemble sur scène, nous demandions à la régie de nous faire des retours. Les décisions finales de mise en scène étaient toutes collectives.
Benjamin : Pour ma part c’était un peu plus complexe, parce que nous avons dû faire la reprise en quatre jours. Nous sommes donc partis de ce qui avait déjà été fait. C’est un groupe qui s’est construit dans l’urgence, ce n’en était pas moins démocratique mais je pense que l’on a moins voté que lors de la création originelle.
La décision collective par le débat et le vote était-elle un moyen de créer votre projet à l’image de la pièce ?
Nathan : Oui c’était fait exprès, nous avons procédé par tours de parole et, à force de discuter, soit nous tombions d’accord, soit nous essayions les idées de chacun jusqu’à ce que l’une d’entre elles plaise à tout le monde.
Benjamin : Nous avons eu le même fonctionnement, chacun avait son point de vue, ce qui donnait lieu à des discussions collectives. Cela ne prenait au bout du compte pas la forme d’un compromis, mais plus d’une accumulation d’idées que l’on étoffait au fur et à mesure jusqu’à ne plus savoir d’où provenait l’idée à l’origine.
Ces personnages n’agissent pas et on peut penser que l’enlisement guette le spectateur qui semble se retrouver au milieu d’un cercle sans fin. Cette idée de « non-action » est elle réelle ?
Nathan : Je ne suis pas d’accord sur le terme « non-action » parce que les débats, même s’ils ne sont pas de l’action à proprement parler, font avancer les personnages. Si nous partons du principe que la parole n’est pas une action, alors effectivement ils n’en ont pas effectué.
Benjamin : Prendre la parole et exprimer son désaccord, c’est déjà agir politiquement. Il s’agit de trouver des solutions pour avancer, remettre en question le propos et le groupe. Ce mythe de l’avancée seulement possible par l’accord de tout le monde me semble faux et irréalisable. Mais il ne faut pas non plus s’oublier dans la parole qui peut perdre de sa substance si elle devient rhétorique. Le plus important dans notre mise en scène est de revenir à une parole concernée, de croire à ce que l’on dit afin de créer une action la plus authentique possible.
La scénographie est très sobre, le plateau quasiment vide tout au long de la pièce, pourquoi ce parti pris ?
Nathan : Cela rejoint notre volonté de « réalité ». Nous voulons adapter notre mise en scène à chaque endroit où nous jouons, raconter une histoire et inviter les spectateurs à la vivre avec nous. Amener un même décor à chaque représentation discréditerait notre propos. Parfois nous savons que le public connaît notre pièce, et nous créons alors un espace pour permettre la discussion. Mais il nous est arrivé de jouer dans un théâtre « traditionnel », frontal, où nous avons décidé de prendre en otage le public comme si nous prenions possession des lieux.
Pourquoi utiliser la vidéo sur scène ?
Benjamin : Nous avons inséré l’usage de la caméra pour installer davantage encore le trouble entre la fiction et le réel. Nous voulons que tout le monde soit George. Le meilleur moyen de faire en sorte que le public se sente concerné passe par un effet de mise en scène. En nous mettant dos à eux, face à la caméra, nous les incluons dans la mise en scène. Ainsi ils sont eux aussi masqués, filmés et projetés sur le mur en fond de scène.
Comment vous est venue l’idée d’utiliser des masques ?
Nathan : Les masques étaient déjà présents dans les didascalies, les personnages arrivaient sur scène avec leurs masques pour tourner le film de propagande. Comme nous avions déjà inclus le public dans cet acte en les filmant eux aussi, il nous semblait logique de leur donner des masques. Ainsi plus rien ne les différencie de nous : « George est nous tous et nous sommes tous George ». Les masques permettent d’indiquer dès le départ que nous nous adressons au public et qu’il fait partie du groupe.
Inclure le public dans la pièce, c’est permettre de transmettre plus facilement un « message » ?
Benjamin : Nous ne jouons pas ce texte pour la beauté du théâtre, mais parce que c’est une réflexion qui nous traverse, qui est très intime et collective à la fois. Nous ne voulons pas nécessairement transmettre un message mais montrer ce que cela raconte de nous. C’est pour cela que nous cherchons le contact avec le public, nous voulons créer une écoute. Si nous avions un public passif en face de nous, les sujets politiques que nous abordons n’auraient pas la même réception.
Nathan : Nous n’avons pas « fermé » le texte, beaucoup de questions restent ouvertes pour que le public s’en pose et se sente concerné d’une autre façon. Nous avons par exemple joué devant d’anciens syndicalistes à qui la pièce a rappelé des grèves menées par le passé. Nous avons aussi joué dans une ferme associative où les personnes vivent en communauté et ont un système de vote : la pièce leur a rappelé leur vie. Chacun a sa petite histoire et en les incluant dans notre spectacle nous leur permettons de raviver des souvenirs et des réflexions.
Quelles ont été vos inspirations dans la mise en scène de cette pièce ?
Benjamin : Quand nous avons commencé la résidence chacun a amené un texte et j’en ai pris un du « Comité Invisible » : L’insurrection qui vient. Un essai politique publié en 2007 par un groupe d’écrivains qui souhaitent rester anonymes. Ils expliquent que tout milieu tend à s’autoconserver, c’est à dire qu’à partir du moment où les syndicats deviennent des syndicats, ils cherchent juste à rester en place. Ils vont alors plus s’attarder sur la structuration de leur syndicat pour continuer à exister, plutôt que de lutter pour les causes pour lesquelles ils ont été créés. Des passages entiers de ces textes sont dans George Kaplan : Sonntag s’en est évidemment inspiré. L’injonction à n’être personne provient de là, et du slogan « I am what I am ».
Nathan : Les inspirations proviennent en grande partie de notre collectif, et des discussions que nous pouvons avoir. Après avoir commencé la création de George Kaplan nous avons hésité à inclure le texte Gênes 01, écrit par Fausto Paravidino, en dernière partie. Cette pièce documentaire parle des manifestations altermondialistes ayant eu lieu pendant le sommet du G8 à Gênes en 2001. Il y a eu des débordements, entrainant la mort d’une personne et faisant une centaine de blessés. La pièce traite du flou médiatique autour de cet événement, et du peu de témoignages que l’on a recueillis.
Pourquoi ne pas l’avoir finalement ajoutée à votre mise en scène ?
Nathan : Ce texte met en scène des répressions violentes des forces de l’ordre, nous ne voulions pas accabler les policiers car ce n’était pas notre propos. Il n’était pas question de créer une pièce manichéenne.
La pièce, à l’origine, comporte trois parties dans trois huis clos différents, pourquoi avoir seulement choisi la première, « Le GGK » ?
Nathan : Nous avons choisi cette partie parce qu’elle nous touchait directement : les personnages ont nos âges et leurs réflexions sont proches des nôtres. La question du temps a aussi beaucoup influencé notre choix. Nous avons réussi à créer une identité propre, singulière, avec cette partie.
Les questions de rapport entre individualité et collectivités semblent rythmer la pièce, comment lier ces deux concepts ?
Nathan : L’individuel et le collectif ne forment pas une dualité, les deux fonctionnent ensemble, en osmose. Nous nous sommes rendu compte en travaillant sur le chœur que nous l’envisagions trop comme une union, alors qu’en réalité c’est une entité composée d’individualités. Il n’est pas question de supprimer son identité au profit du groupe. Mais il n’est pas question non plus de revendiquer son individualité en faisant passer le groupe à la trappe. C’est la réflexion présente tout au long de George Kaplan, il nous faut créer un équilibre entre ces deux extrêmes.
Benjamin : Ce n’est pas non plus un compromis, il faut l’envisager comme une sorte d’obligation, les deux doivent coexister et nous devons trouver des solutions pour cela.
Quelle réflexion sur notre société offre à voir votre mise en scène ?
Nathan : Imaginons pousser le GGK pour que cela devienne un vrai mouvement. Dans notre société actuelle, si jamais une multiplicité d’individus créait des choses au nom d’un même collectif, s’autorisant à supprimer leurs identités pour faire partie d’un tout qui bouleverserait la société, alors cela pourrait vraiment créer quelque chose. Nous avons réalisé que cette pièce, George Kaplan, permet d’ouvrir la parole en dehors de la fiction. À l’image du mouvement Nuit Debout, auquel j’ai participé, qui a permis de réouvrir le débat sur la place publique malgré une absence totale de réponse du gouvernement. Le projet GGK me permet d’exercer une continuité dans ma pensée politique : nous l’offrons au spectateur et le faisons participer. Ainsi quand il ressort de la salle, il ne passe pas directement à autre chose, il continue le débat initié par la pièce.
Benjamin : En écoutant Nathan j’ai réalisé que si nous posions cette question aux autres membres du groupe mais aussi au public, personne n’aurait la même réponse. Parce qu’elle est très individuelle, subjective. Je pense profondément que le rapport entre notre mise en scène et la société est directement présent dans notre choix de présenter ce texte aujourd’hui, dans ce monde là.
Entretien mené par Julie Turco, étudiante en Master MCEI à l’Université Paris Nanterre.