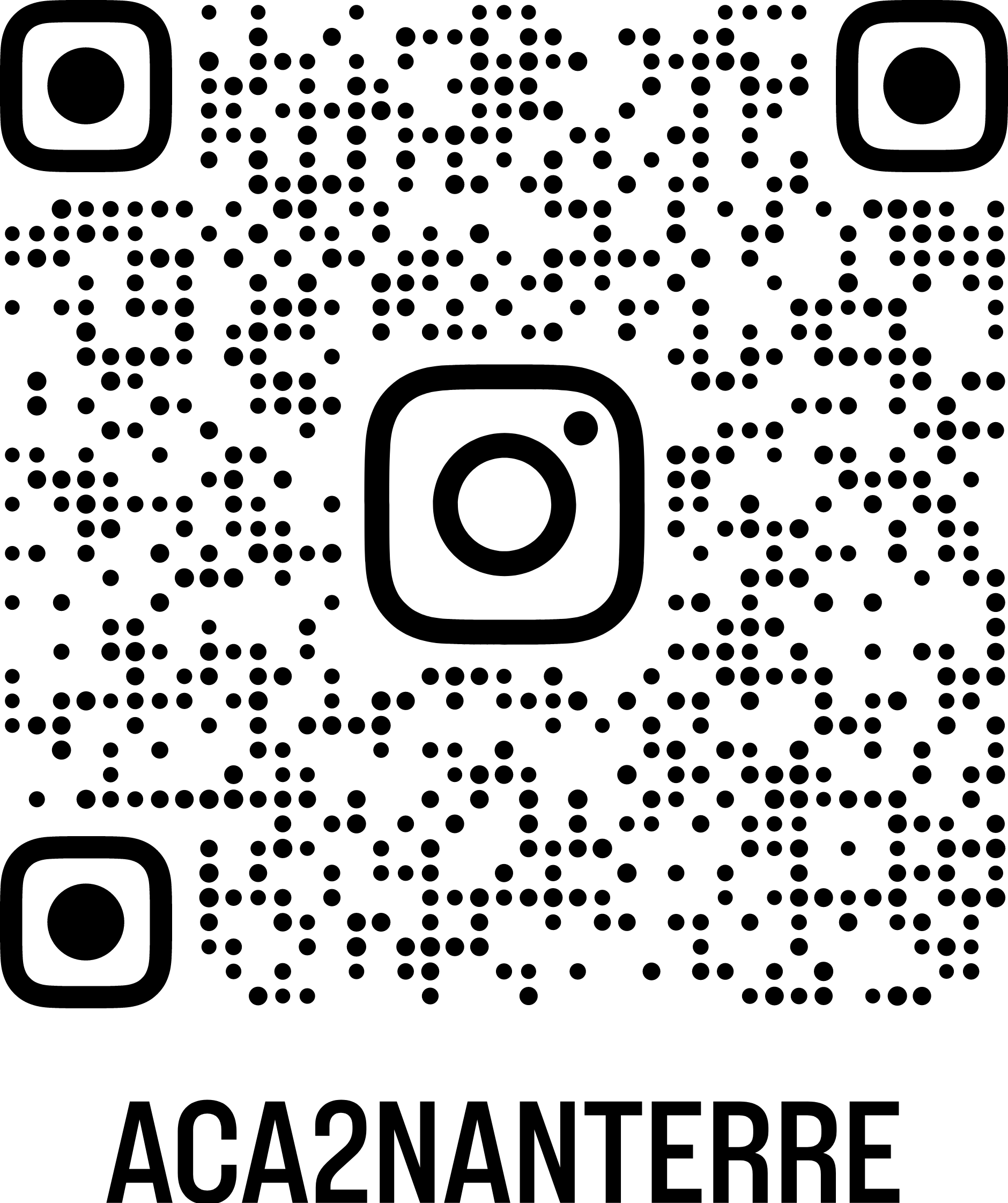Les Mains froides
Centre de Formation d’Apprentis des Comédiens d’Asnières
Date : Mercredi 2 décembre 2015
Horaires : 18h30 - 19h20
Lieu : Espace Pierre Reverdy
Durée : 50 minutes
Discipline : Théâtre / Musique

© Guillaume de La Forest Divonne
- Mise en scène : Nicolas Candoni et Charlotte Desserre
- Interprétation : Nicolas Candoni, Paul Delbreil, Charlotte Desserre, Nicolas Guillemot, Elisa Habibi, Charles Leplomb, Félix Martinez, Mathilde Moulinat, Laurent Prache, Coralie Russier
- Son : Charloes Leplomb
Une bande de potes âgés de 15 ans : Kaleb, Lenny, Nora et Oswald.
Kaleb, c’est le chef, le héros, le Tony Montana du collège, celui qui sait se battre et qui ne peut pas mourir. Oswald, c’est le souffre-douleur du « type au pull rouge ». En voulant protéger son ami Oswald lors d’une altercation dans la cour, Kaleb meurt tête contre le sol, une lame plantée dans le dos.
Face à cet événement, incompréhensions et tensions se creusent entre adultes et ados. Choqués et démunis, les parents cherchent un responsable. La mère de Kaleb tente de faire son deuil à l’aide d’un épouvantail qu’elle habille comme son fils. L’institution et les médias s’emparent du fait divers. Le principal de l’établissement scolaire se sent coupable de n’avoir pu empêcher l’agression et doit faire face aux questions qui le menacent.
Par quels moyens ces adolescents, bouleversés par la perte de leur ami et déçus par l’incapacité à réagir dont font preuve les adultes, parviendront-ils à faire leur deuil et à agir pour se reconstruire et pour se sentir vivants ?
Présentation du projet Les Mains froides
Notre amitié, notre complicité, notre intérêt commun pour un théâtre sensible qui habite les enjeux et les questions de notre époque, nos parcours respectifs en Lettres et Études théâtrales, notre curiosité pour les écritures contemporaines, nos conversations passionnées aux sorties des théâtres nous ont donné l’envie de développer un projet de mise en scène à deux.
Nous avons découvert, il y a deux ans, Les Mains froides dans le cadre d’un partenariat entre les écrivains formés à l’ENSATT et les apprentis-comédiens du CFA. Plusieurs textes ont été envoyés par les jeunes auteurs de Lyon. Nous avons eu un coup de cœur pour cette pièce de Marylin Mattei sur les adolescents, leur rapport aux adultes, à l’autorité, à la violence et à la mort. Les Mains froides évoque avec justesse et originalité la jeunesse et l’innocence. La langue de Marilyn Mattei est singulière, percutante, instinctive.
Nous avons proposé une lecture publique au Studio Théâtre d'Asnières en 2013. L'accueil enthousiaste du public nous a donné envie de poursuivre ce travail avec (quasiment) la même équipe et de co-mettre en scène ce très beau texte, pas encore édité, pour donner vie aux personnages, aux images qu'ils ont suscitées en nous et explorer la fureur de vivre, le vertige de l’adolescence.
Entretien mené par Juliette Pacalet, étudiante en Master 1 Humanités et Industries créatives à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Un vendredi matin d'octobre, je rejoins près de la Place de Clichy Nicolas Candoni et Charlotte Desserre, metteurs en scène de la pièce Les Mains froides de Marilyn Mattei. Le bistrot dans lequel ils m'ont donné rendez-vous s'appelle « Le Cyrano ». Un cadre parfait pour parler théâtre, et évoquer avec eux la mise en scène des Mains froides, texte inédit qu'ils présentent en compétition pour le festival Nanterre Sur Scène.
Les dix comédiens de cette pièce sont passés par le CFA des Comédiens d'Asnières. À quelle occasion avez-vous formé la troupe de ce spectacle ? Aviez-vous déjà travaillé ensemble ?
Charlotte Desserre : Il faut savoir que le CFA [Centre de Formation des Apprentis] des comédiens est une structure particulière : c’est un centre de formation professionnalisant, qui nous donne un statut d’apprentis.
Nicolas Candoni : La formation dure trois ans. Pendant ces trois années, nous suivons des cours ensemble, et, comme nous sommes en alternance, nous avons aussi des projets professionnels. Il peut s’agir de projets isolés, lorsque nous sommes en convention extérieure, mais très régulièrement, nous nous retrouvons tous dans des productions qui sont jouées au Studio-Théâtre d'Asnières.
Est-ce la première fois que vous mettez en scène une pièce ?
N.C. : Non. Des envies de mise en scène il y en a depuis longtemps... Moi, j’ai déjà mis en scène des spectacles – toi aussi Charlotte...
C.D. : Moi, j’ai été plusieurs fois assistante à la mise en scène, et j’ai aussi mis en espace des lectures, mais c’était des projets plus restreints.
C’est fréquent de travailler en duo comme vous le faites ?
N.C. : Non, ce n’est pas très fréquent. Nous, on se connaît depuis longtemps, et on a toujours partagé un goût pour le même type de recherches théâtrales. Nous avons tous les deux aimé le texte de Marylin Mattei, et c’est donc presque naturellement que nous avons décidé de le monter ensemble.
J’allais justement vous parler de ce texte, qui n’a pas encore été édité. Comment en avez-vous eu connaissance, et pourquoi vous a-t-il particulièrement marqués ?
C.D. : Pendant notre formation à Asnières, nous avions un partenariat avec la section auteur dramatique de l’ENSATT [École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, à Lyon]. Il y avait un comité de lecture, et nous sommes tombés sur ce texte. On l’a aimé, et on en a monté une première mise en espace, il y a deux ans.
En quoi consiste une lecture ?
C.D. : C’est une lecture texte en main, mais jouée, que l’on prépare très rapidement. Pour cette pièce, la mise en scène s’est vraiment décidée au moment de la lecture.
N.C. : On avait mis une table et décidé du système d’entrée et de sortie, on avait déjà choisi le principe de la frontalité. Charles, le musicien, était déjà là, avec la guitare et l’ordinateur ; tous les choix de musique se sont faits à ce moment-là. Tout existait déjà ; on a presque présenté un spectacle. Et c’est ce qui nous a donné envie de le poursuivre, parce qu’on a vu que cela marchait bien, que les gens étaient pris dans l’histoire et captaient bien les sentiments et l’écriture. De notre côté, on a trouvé ce texte très agréable à jouer.
Par exemple, dans le cas du texte de Marylin Mattei, combien de temps avez-vous pris pour en proposer une lecture ?
N.C. : On a eu trois services de répétitions, donc douze heures seulement.
C.D. : Mais en fait, cela suffit pour présenter un objet théâtral.
NC : Si on veut être exact, ce n’était pas vraiment un spectacle qu’on a présenté, c’était plutôt un geste. Et c’est ce qu’on essaie de conserver dans le spectacle que ce geste est devenu : on voudrait en garder la spontanéité, la simplicité, l’urgence.
J’imagine que dans votre formation vous avez eu à aborder le répertoire classique. Est-ce qu’en tant que metteur en scène on aborde une pièce contemporaine de manière différente ?
N.C. : Non, je ne crois pas.
C.D. : Moi non plus.
N.C. : En tout cas, pas dans la manière dont on envisage la mise en scène. Il s’agit d’essayer de comprendre le sens de la pièce, son écriture et d’essayer de faire entendre la langue. Je pense que si on s’attaque à Marivaux ou à Molière, il y a le même travail à faire. Et puis, surtout, ce qui nous intéresse avec Charlotte, que ce soit sur une pièce classique ou une pièce contemporaine, c’est de faire entendre l’actualité du propos. C’est pour cela qu’on monte des pièces classiques d’ailleurs, parce sinon je crois que ça n’aurait aucun intérêt. De toute manière, les grands textes que l'on connaît aujourd'hui sont ceux qui défient le temps, qui restent d'actualité. Et ce sont ceux qui nous intéressent. Donc je pense que c'est la même démarche : dans le cas d'une pièce classique, on va trouver l'équivalent du propos dans l'actualité. Dans celui d'une pièce contemporaine, l'actualité du propos est peut être plus évidente, mais encore faut-il la faire entendre et trouver la bonne forme pour cela.
Justement, selon vous, quelle résonance votre pièce a-t-elle avec la société actuelle ?
C.D. : Je pense que c'est assez clair. Par exemple, une semaine avant que l'on ne joue au théâtre à Montmartre, il y a eut une tuerie dans un lycée aux États-Unis...
N.C. : Malheureusement, la violence en milieu scolaire est un sujet tout à fait d'actualité. Il suffit d'aller sur Google pour trouver des reportages sur des couteaux sortis dans une cour, dans des collèges ou des lycées. Outre le thème de la violence, la pièce aborde aussi la question du rapport entre adultes et adolescents. Ce qui nous intéressait dans la pièce, c'était de voir se jouer le moment où l'on grandit et où l'on se défait de l'emprise des adultes. Même si l'on a besoin d'eux, il y a un moment où l’on s'affranchit d'un héritage lié à l'histoire familiale, à l'éducation, aux codes sociaux, pour pouvoir écrire sa vie, son destin. Le sujet de la pièce donne l'occasion d'écrire ce moment de séparation entre les adultes et les adolescents, et montre l'incompréhension qui peut régner entre eux. L'intolérance, la bien-pensance, l'excès d'autorité, ou au contraire de prévenance des adultes entraînent leur incapacité à bien comprendre. Les adolescents s'aperçoivent alors qu'ils ne peuvent pas régler leurs problèmes avec les solutions des adultes.
C'est vrai que l'on voit apparaître toute une panoplie de caractères d'adultes à travers les parents des trois personnages, et finalement aucun ne correspond à la situation.
N.C. : Dans les trois cas, ils ne sont plus un secours pour leurs enfants, ils ne peuvent plus les aider et n'arrivent pas à répondre. C'est un moment où les adolescents doivent écrire leur vie eux-mêmes, se construire par eux-mêmes. Et c'est intéressant. Pour en finir avec la question précédente, la pièce est actuelle parce qu'elle questionne le rôle tenu par les institutions et les médias. Il y a un drame, et on voit comment l'institution s'en empare, et toute l'hypocrisie qui accompagne cette appropriation. À travers les médias qui viennent interroger les enfants, on retrouve le côté « il faut réagir tout de suite » de BFMTV ou des chaînes d'informations continues.
C.D. : Il y a aussi une question que je trouve intéressante, c'est celle de la responsabilité. La pièce pose cette question : qui est responsable de la mort de cet enfant ? Et cette volonté de trouver un responsable est, je trouve, une démarche très actuelle. Lorsqu'un drame se produit, on veut savoir : « à cause de qui, pourquoi » ?… Et je trouve intéressant que la pièce n'y réponde pas.
J'ai d'ailleurs l'impression que la mise en scène de la pièce nous amène à ne pas trouver un responsable dans l'un des personnages, mais plutôt dans la société qui les entoure.
N.C. : Oui. Ce sont des jeunes gens qui a priori vont bien, qui sont issus d'un milieu qui n’est ni particulièrement aisé, ni particulièrement pauvre. Ils ne sont pas en difficulté socialement, ce sont des jeunes gens « normaux », en quelque sorte. Pourtant, ils subissent quand même une forme de violence liée à l'incompréhension des adultes, à l'influence des médias, au système scolaire tel qu'il existe (sans vouloir faire de la provocation par rapport à ça, le texte est beaucoup plus subtil). D'où, peut-être, les vidéos projetées au début de la pièce : on diffuse des images de bagarres filmées par des élèves eux-mêmes, avec leurs portables, dans la cour. Ce que je pense, c’est que même si ces jeunes ne sont pas forcément touchés par les difficultés sociales, ils sont nourris par la violence qui tourne en boucle à la télé, ils sont victimes de l'incompréhension des adultes, et aussi déstabilisés par le vertige de cette période adolescente. Et ils répondent à tout cela par la violence. La violence appelle la violence : c'est pour cela que l'on peut, d'une certaine manière, rejeter la faute sur la société.
En ce qui concerne le choix du dispositif face public, et le choix d'un lieu unique : était-ce indiqué par les didascalies ?
N.C. : Non, le texte ne donne pas d'indications là-dessus. Seul le fait que tous les parents doivent être joués par les mêmes acteurs est spécifié par les didascalies. Par contre il n'y a pas de précisions pour le dispositif. C'est une succession de scènes, et il y a d'ailleurs beaucoup de lieux évoqués : chez les parents d'Oswald, de Lenny, de Nora, de Kaleb ; chez le principal, puis au cimetière, et dans l'établissement scolaire. Sept lieux au total.
C.D. : Il y a même une scène devant la porte du collège.
NC : Nous, on a choisi de tout faire dans un décor unique, et l'évocation d'une salle de classe nous semblait être un bon moyen de recréer l'ensemble de ces lieux. En ce qui concerne le choix de la frontalité, cela nous a été inspiré, entre autres, par la comparaison de la pièce avec le cinéma. Je trouve qu'avec ses phrases courtes, l'écriture de Marilyn Mattei est assez cinématographique. D'autre part, le thème nous a vraiment fait penser au cinéma de Gus Van Sant, notamment à Elephant - on ne peut pas ne pas y penser. Le cinéma a le pouvoir de faire un zoom, de filmer les gens en gros plan... Et en fait, le théâtre le permet aussi. Pour permettre cet effet de zoom, il nous a semblé évident qu'il fallait choisir la frontalité et l'absence de quatrième mur. Notre travail dramaturgique a été aussi été influencé par des photographies contemporaines, des portraits : là encore, le fait d'être face au gens recrée le lien qu'on peut avoir avec un portrait photographique.
Quel est le nom des photographes qui vous ont inspirés ?
N.C. : Il y en plusieurs : on a parlé ensemble de Valérie Jouve, de Larry Clark. Ce sont souvent des artistes qui ont travaillé sur l'adolescence.
Pourriez-vous évoquer certains de vos autres choix de mise en scène ?
N.C. : On nous reproche parfois le fait qu'il y ait beaucoup de musique. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on vit avec de la musique tout le temps : on travaille avec de la musique, dans le métro on écoute de la musique... alors ça me paraît évident qu'une bande-son accompagne la pièce.
C.D. : On nous a fait aussi la remarque que ce ne sont que des musiques des années 1980, mais ce n'est pas volontaire.
N.C. : On n’est pas obligé de le faire en regardant le spectacle, mais si on y fait attention, les musiques sont en relation avec ce que ressentent les personnages au moment où ils l'écoutent. D'abord du point de vue des paroles, si on les comprend, mais aussi parce qu'elles ont une couleur assez mélancolique, un peu électrique, dissonante.
La musique fait d'ailleurs penser à l'univers de Gus Van Sant, elle aussi. Pas seulement Elephant, mais aussi Paranoid Park, par exemple.
N.C. : Paranoid Park on l'a regardé, oui, bien sûr. On n’a pas cherché à calquer la pièce sur Elephant, mais c'est une influence majeure qu'on retrouve dans le thème, dans la musique, dans les costumes, avec l'utilisation des sweats à capuches, dans les lumières assez froides... On l'assume totalement d'ailleurs, et je pense que Marilyn Mattei aussi. Elle n'a pas pu ne pas y penser en écrivant la pièce.
Est-ce qu'on peut aussi faire un parallèle avec le film Le cercle des poètes disparus ? On y retrouve les thèmes des relations entre adultes et adolescents, mais aussi le poème de Walt Whitman, « Oh capitaine, mon capitaine », qui est récité intégralement par Lenny dans la pièce.
C.D. : Oui, c'est vrai, mais je n'y avais pas pensé.
N.C. : Alors moi j'avoue ne jamais avoir vu le film !
C.D. : Je n'en étais pas consciente, mais c'est vrai qu'il y un parallèle !
Pourriez-vous évoquer d'autres de vos influences ?
C.D. : On aime beaucoup Stanislas Nordey, qui fait beaucoup de face public.
N.C. : Oui, c'est une influence, et c’est vrai que dans tout ce qu'il monte, on trouve des lignes face public. Nous n’y avons pas pensé spécialement pour ce spectacle, mais nous avons tellement vu ses pièces, que cela agit forcement quelque part en nous. De manière générale, on peut retrouver cette influence dans beaucoup de nos projets : je prépare des répétitions pour un autre spectacle, et on retrouve ce procédé du face public. De manière moins radicale peut-être, mais il est toujours quelque part. Dans Les mains froides, nous le tenons du début à la fin, et je trouve cela génial.
Du point de vue du jeu, est-ce une difficulté supplémentaire pour les acteurs ?
C.D. : Oui c'est une difficulté, pour certains plus que pour d'autres... Mais je crois, en tant que comédienne, que cela force à l'écoute, puisqu'on ne peut pas être avec l'autre par le regard.
N.C. : Pouvoir rebondir sur la réplique qui est envoyée sans voir l'autre, cela oblige à être très disponible.
C.D. : Il faut être très présent.
N.C. : Et la difficulté c'est de ne pas s'éteindre. Je ne le dis pas de manière péjorative, mais la personne en face peut vraiment être une béquille. Alors que là, le regard ne doit pas s'éteindre. Il faut être très mobilisé sur l'avant, il faut aussi décider en amont du jeu corporel, parce que ce n'est pas naturel de faire un mouvement du bras pour dire « qu'est-ce que tu penses ? », comme ça... Du coup il faut se concentrer et faire comme si la personne était devant.
Donc vous projetez la personne en face de vous, lorsque vous jouez ?
N.C. : Moi je n'y pense plus, c'est devenu automatique.
C.D. : Moi non plus.
N.C. : Mais oui, au début il fallait imaginer qu'il y avait quelqu'un devant.
La thématique de cette pièce est particulièrement grave, lourde. Selon vous, quels étaient les écueils à éviter pour le jeu et la mise en scène ? Quelles solutions avez-vous trouvé pour les éviter ?
N.C. : La forme nous a beaucoup aidés à ne pas tomber dans le pathos ou le misérabilisme. Et nous a aussi permis d'éviter le « jeu télé ». Dans l'interprétation et le jeu, on voulait fuir la théâtralité pour ne pas déclamer le texte : il me semblait que par rapport au texte, c'était bien de « jouer cinéma ». En revanche, on ne pouvait pas se permettre une mise en scène réaliste : d’où le face public et aussi la présence du musicien sur scène – cela crée une forme théâtrale qui évite l’écueil du jeu télé.
C'est vrai que dans le texte Marilyn Mattei utilise un langage « de tous les jours », mais il y a une vraie poésie de la langue.
N.C. : Oui, le texte peut avoir l'air quotidien à première vue, mais en réalité il est très écrit. Il y a une vraie sensibilité, une poésie, une fulgurance, parfois, qui heureusement nous éloigne du réalisme plat des séries télé. Et il est très beau pour ça.
Le dispositif scénique évoque aussi la forme du reportage…
N.C. : Oui c'est vrai, le face public c'est aussi le témoignage. Et c'est vrai que ça se passe sur des journées précises, qu'on donne des dates... Les lumières crues, elles aussi, peuvent évoquer le témoignage. On n’a pas cherché à faire des effets de lumières, et il y en aura encore moins à Nanterre : on restera dans des lumières pâles, que je trouve très belles.
Cette impression de témoignage est renforcée par le moment où le personnage vient prendre le micro pour s'adresser au public.
N.C. : Le procédé du micro n'était pas dans le texte, mais l'auteur a écrit un monologue par personnage, et on a décidé de le traiter comme ça. C'est un moment de bilan, où le personnage fait le point avec lui même.
Finalement, le seul élément qui m’ait un peu gênée dans la représentation du Théâtre de Montmartre, c'est la présence du musicien sur scène.
N.C. : C'est un choix que nous avons fait parce que nous aimons l'idée d'avoir la musique en train de se faire. C'est surtout une question de forme, d’atmosphère. Mais c'est une chose à laquelle nous devons encore penser : à Montmartre, c'est vrai qu'il était trop proche de nous. A l'audition de Nanterre, il était placé au fond de la classe. Cela dépend bien sûr de la configuration des lieux dans lesquels nous jouons.
En tant que jeunes metteurs en scène, est-il difficile de trouver des théâtres dans lesquels jouer, d'assurer la promotion du spectacle ? Étiez-vous préparés à cette dimension de la profession ?
N.C. : C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, d'énergie, … et d'argent. On avance beaucoup d'argent pour nos spectacles, parce que nous ne pouvons pas encore nous financer. Mais il faut le faire, justement parce que nous sommes jeunes, sinon d'autres le feront à notre place... Je pense qu'il ne faut pas cacher cette réalité, mais je ne veux pas donner l'impression de me plaindre, parce que malgré tout, nous le faisons avec plaisir. Et c'est le plus important.