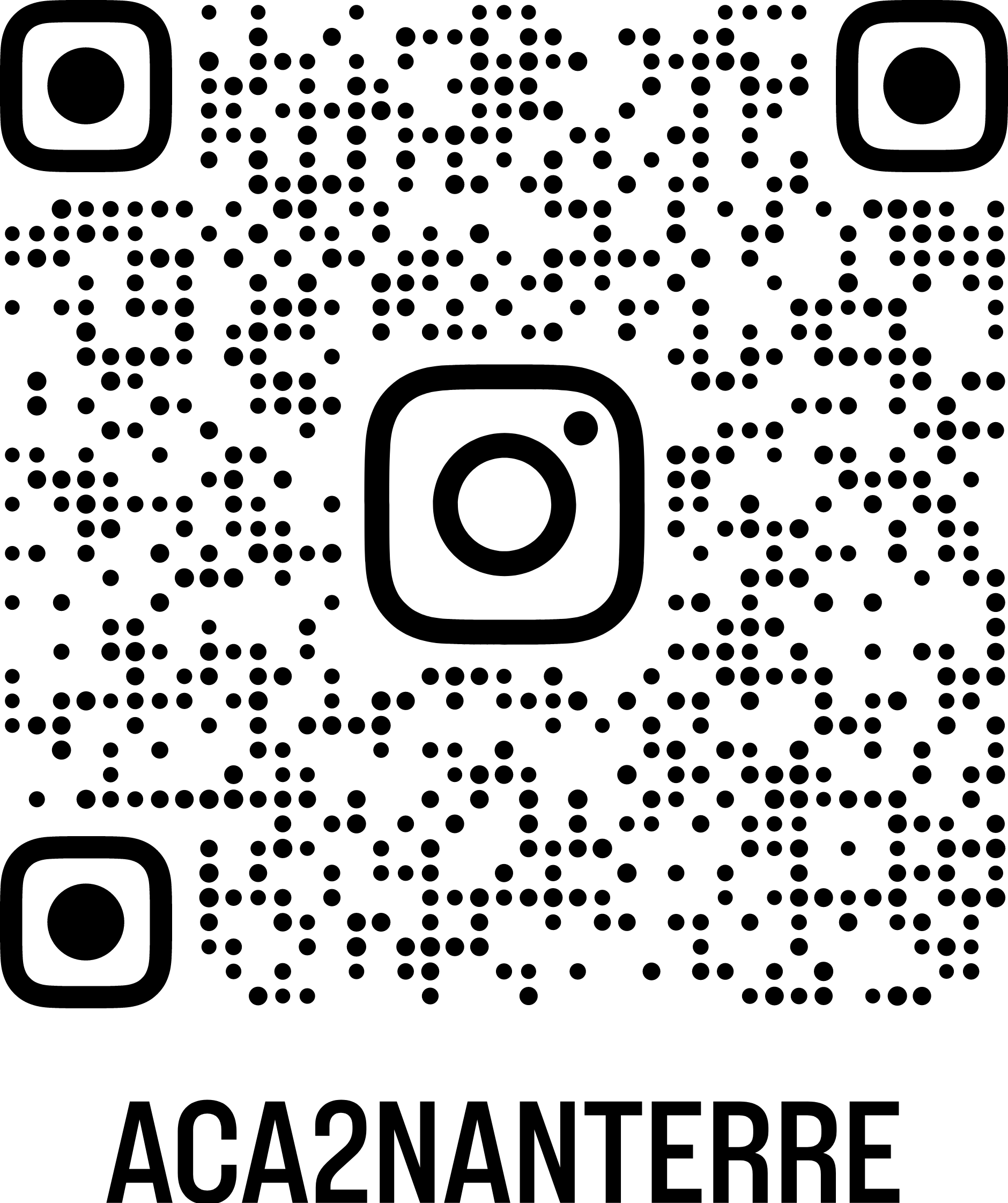Tout va bien. Tout va bien aller maintenant.
Université Lille 3
Date : Jeudi 3 décembre 2015
Horaires : 18h30 - 19h20
Lieu : Espace Pierre Reverdy
Durée : 50 minutes
Discipline : Théâtre / Danse

© Charlotte Dutilleul
- Mise en scène : Caroline Decloître
- Interprétation : Théo Borne, Lauriane Durix, Alexis Hedouin, Clémentine Julienne, Anne-Charlotte Zuner
- Regard dramaturgique : Charlotte Dutilleul
- Création lumière : Hugo Bremond
- Régie : Pauline Granier
Tout doit être sous contrôle.
Les émotions. Les passions. Les désirs. L’image de soi.
Tenir la face, ne rien lâcher, tout maîtriser face à l’autre dont on essaye d’appréhender le regard. Rester en tension.
Comme un machinerie bien huilée, tout est programmé et contrôlé, selon des codes et des paradigmes profondément ancrés en nous. Puis un événement advient, minuscule grain de sable qui s’immisce dans les interstices des rouages, et tout déraille.
Dans Tout va bien. Tout va bien aller maintenant., le handicap d’Adam (le fils) agit comme un grain de sable qui fait exploser les mécanismes d’une famille bien comme il faut, où tout est contrôlé et programmé.
Parce que le langage est devenu obstacle, c’est par le corps que chacun exprime sa fragilité, ses désirs et sa solitude dans ce microcosme familial un peu tordu, distordu, mal-foutu, qui doit faire face à ce qui lui échappe.
Comment reconstruire le quotidien quand les projections dans l’avenir et les rêves de futur s’écroulent ? Comment ne pas perdre la face et faire « bonne figure » ? Quelle image de nous voulons-nous donner ? Qu’est ce qui si tend sous le regard de l’autre ?
Cinq interprètes donnent corps et voix à ces questionnements. Ils explorent les processus de construction des représentations de soi, cherchent ce qui se tend et ce qui se défait sous le regard de l’autre en empruntant leur langage à différents médiums artistiques.
Dans un tissage des écritures chorégraphiques, photographiques et théâtrales, ils donnent à voir la construction des représentations de soi offertes au monde.
Présentation de la compagnie
Créée en 2014, la compagnie Hej Hej Tak réunit des danseurs et des comédiens formés à l'université Lille 3, au conservatoire de Lille ou à l'école du ballet du Nord. Animés d'un même désir d'explorer, ensemble, notre langage artistique, nous nous sommes rencontrés / retrouvés / (re)découverts autour de ce premier projet Tout va bien. Tout va bien aller maintenant. Le texte, écrit par Caroline Décloitre, a constitué notre terrain de jeu qui fut le lieu d'explorations, entre travail de la langue, du jeu et du corps. Par le training physique, l'épuisement du geste, l'accumulation d'énergie, nous recherchons le lâcher prise, ce qui échappe à notre contrôle. C'est donc dans cette recherche éminemment corporelle et ce plaisir jubilatoire de travailler avec l'Autre, que s'inscrit notre travail.
Nous avons eu la chance de présenter ce premier projet au théâtre d'Arras en clôture du festival Arsène 2015 et nous avons été nommés « Coup de cœur du jury » du festival interuniversitaire de Lille 3. Forts de ces expériences et de ces encouragements, nous travaillons encore, toujours, à aller plus loin dans notre recherche.
Présentation du projet Tout va bien. Tout va bien aller maintenant
Ca a commencé par le désir.
Le désir d’écrire à propos du poids du handicap qui pèse sur une famille, en explorant les mondes individuels, les complexités et les contradictions de chacun de ses membres.
Le désir d’interroger la construction de l’identité face aux autres, dans toute l’ambiguité de notre rapport à la norme.
Le désir de mots à jouer, de langue à machouiller.
Alors il y a eu un texte, écrit en mai 2014 : Tout va bien. Tout va bien aller maintenant. Mais au fil de l’écriture, les images de plateau prenaient le dessus, le texte en tant qu’entité finie en elle-même perdait de son sens, laissant comme un goût amer d’inachèvement. Il fallait travailler en corps pour explorer pleinement ses interrogations, épidermiques, autour du handicap et de la représentation de l’individu. Il fallait de la matière sonore. Il fallait de la photographie… Il fallait du vivant.
Alors il y a eu le désir d’activer ce texte au plateau. Allez. Allons. Allons-y.
La compagnie Hej Hej Tak est donc née et réunit aujourd’hui des interprètes formés à la danse et au théâtre, constituant un collectif complémentaire et organique.
Ca a commencé comme ça. Par le désir.
Entretien mené par Juliana Feral, étudiante en Master 1 Humanités et Industries créatives à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Même pendant les vacances universitaires, Caroline Decloître, étudiante en master de danse à Lille, ne cesse de courir. Avec sa compagnie Hej Hej Tak, elle revient d'une semaine en résidence à Nanterre. Une fois son sac de voyage à terre et son souffle repris, Caroline nous accorde pourtant un moment pour nous parler du spectacle qu’elle met en scène, Tout va bien. Tout va bien aller maintenant, programmé le jeudi 3 décembre au festival Nanterre sur Scène.
Le thème principal du spectacle est le handicap : comment sont nés ce questionnement et ton envie d’écrire là-dessus ?
Caroline Decloître : J’ai une grande sœur qui est en fauteuil roulant, donc je pense que ce sont des questionnements qui me touchent depuis un moment. Mais l’envie de les travailler d’un point de vue artistique émane aussi de mon travail de recherche et de mon mémoire. Je travaille sur la question de la mise en scène des corps hors-norme, que ce soit en théâtre ou en danse. Ce qui m’intéressait vraiment, c’était justement de savoir comment représenter le handicap et comment le traiter sans le caricaturer. Je ne voulais pas travailler avec un interprète porteur de handicap, car finalement montrer le handicap n’était pas mon but ; et puis je ne me sentais pas non plus de chercher à tout prix un porteur de handicap avec qui j’aie envie de travailler. Du coup, avec Alexis [Hedouin], le danseur qui joue le rôle d’Adam, on a décidé de chercher le handicap ailleurs. Finalement, je pense que le spectacle ne traite pas du handicap en tant que tel, mais plus de la façon dont on le reçoit : par exemple on ne s’est jamais demandé quel handicap précis avait le personnage d’Adam. On ne voulait justement pas rentrer dans des clichés et des caricatures ; on voulait plutôt comprendre ce que le handicap peut nous renvoyer et comment nous le percevons.
Tu ne cherches donc pas à montrer le handicap sur scène mais juste à révéler quelque chose chez le spectateur… quoi, en l’occurrence ?
C.D. : Je ne sais pas ce qu’on cherche à révéler chez le spectateur. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéressait, c’était de savoir finalement ce qui nous paraissait hors-norme ou pas. Qu’est-ce qui provoque ce sentiment conjoint d’étrangeté et de curiosité quand l’on croise une personne handicapée, amputée, une personne qui a un corps qui sort de la norme ?
Qu’est-ce qu’un corps aux normes ?
C.D. : Ce sont les corps que l’on peut voir à la télé ou au théâtre. Ce sont surtout des corps lisses, des corps qui se ressemblent. On voulait savoir pourquoi ce personnage handicapé dérange au sein de sa famille et au sein de la société de façon plus générale. On voulait voir la frontière entre la norme et le hors-norme. On a travaillé par exemple sur des gestes de la vie quotidienne, et on les a décalés jusqu’au moment où ils nous paraissaient étranges.
À travers le handicap d’Adam tu voulais montrer le hors-norme en général ?
C.D. : Oui, complètement, parce que finalement le corps hors norme n’est pas seulement le corps handicapé, ou celui qui ne répond pas à ce que l’on voit à la télé. Il peut s’agir aussi du corps d’un danseur professionnel ou d’un contorsionniste. Lors d’un spectacle où il y avait justement un contorsionniste, je m’étais demandé ce que cela provoquait dans mon corps. Et bien, cela me faisait à peu près la même chose que pouvait me faire une personne amputée ou une personne en fauteuil roulant. J’avais envie de regarder, mais en même temps, c’était étrange et cela me faisait mal car c’était quelque chose qui m’était inconnu.
Au niveau du travail de l’écriture, quelles références t’ont permis d’arriver à ce texte ?
C.D. : Ce spectacle est un mélange de toutes nos références. Par exemple, je lis beaucoup Alessandro Baricco qui, je pense, m’a beaucoup influencée - peut-être pas dans l’écriture mais dans la façon de penser les personnages, et dans la façon de créer une histoire collective avec plusieurs fils individuels. Pour l’écriture et la langue, j’ai beaucoup travaillé avec une comédienne qui produit de la poésie sonore. Elle se base sur la sonorité des mots et sur ce que cela provoque. Et puis je suis aussi une grande admiratrice des travaux de Jean-Pierre Siméon. Lui aussi travaille la langue et pas seulement le sens des mots. Mais on a beaucoup travaillé aussi sur la question de l’autoportrait photo. Notre principale référence c’était Francesca Woodman. Cette artiste a fait principalement des autoportraits, où elle met son corps dans des situations ou des postures qui nous sont étrangères. Elle travaille aussi sur la question de la disparition du corps, à la fois visible et caché dans l’environnement. Cette question-là nous a vraiment aidés pour notre création plateau. Il y a eu aussi les autoportraits de Cindy Sherman, qui se déguise ou se maquille, et crée ainsi des personnages qui la représentent mieux que sa propre personne.
Lors de votre travail, avez-vous plutôt travaillé l’autoportrait du comédien, ou celui du personnage ?
C.D. : En fait, on a travaillé les deux : d’abord l’autoportrait de chacun, puis celui du personnage. Je voulais surtout attirer l’attention sur le fait que l’image de cette famille est bousculée face au handicap. Cette image de famille parfaite, modèle, ne fonctionne plus puisqu’il y a ce personnage qui dérange : on ne sait plus comment se représenter. Chacun a donc exploré un artiste qui fait beaucoup d’autoportraits pour voir comment cela pouvait se construire. L’autoportrait est d’ailleurs une question universelle : comment tu te représentes, quelle photo de profil tu choisis sur Facebook... Ce travail a beaucoup alimenté leur personnage puisqu’ils sont tous partagés entre l’image qu’ils renvoient au reste de la famille et leur image « véritable ». Ils doivent faire bonne figure et garder la face mais en même temps chacun se casse la gueule derrière ce grand sourire. Mais il s’agissait surtout d’un outil de travail, donc ce n’était pas forcément intéressant de le rendre visible et de le donner à voir sur scène. C’est pour cette raison qu’on a supprimé les autoportraits diffusés en fond de scène.
La question de la représentation de soi est très présente dans votre spectacle. Pourquoi donner autant d’importance au regard de l’autre et à ce que l’autre reflète en nous ?
C.D. : D’abord parce que c’est une question qui se pose de façon générale au sein d’une famille. Dans la famille qu’on a mise en scène, ils contrôlent beaucoup leur image. Et ils sont tous très certains et très sereins sur ce qu’ils renvoient. La crise fait ensuite qu’ils partent dans tous les sens. Il faut réapprendre déjà à être ensemble et surtout savoir comment on va se montrer aux autres. Et pour moi le hors norme est très révélateur de la façon dont on se perçoit. Si quelqu’un porteur de handicap était regardé et perçu normalement, la question ne se poserait pas. Ce n’est pas le cas ; donc la question du regard de l’autre est importante. Et puis même dans le spectacle, ils sont tous sur scène en même temps, et les autres voient tout ; leur regard est omniprésent. À un moment le personnage de la mère part dans tous les sens ; elle se crée cette espèce d’histoire d’amour avec un homme dont on ne sait pas s’il existe. Et ce fantasme, elle le cache aux autres par peur du regard qu’ils vont poser sur elle et parce qu’elle doit garder la face en tant que mère de famille. Il faut garder une bonne image, pour les autres mais aussi pour soi. C’est un double jeu permanent.
D’où la chanson « On rit encore » d’Arthur H ? Elle était prévue dans l’écriture ?
C.D. : Elle n’était pas prévue avant. On l’a choisie parce qu’elle raconte l’histoire d’un cirque-cabaret dont les personnages ne vont pas bien mais qui rient encore. Cela correspond parfaitement au spectacle où les personnages tentent de se convaincre que « ça va aller ». On n’a gardé que le refrain, parce que le reste de la chanson raconte vraiment une autre histoire, qui n’est pas la nôtre. Les comédiens la chantent à un moment où le personnage du père a vraiment besoin d’être rassuré et d’avoir des gens qui lui disent : « allez, ça va aller ». Et le fait de chanter ensemble raconte déjà quelque chose sur cette famille.
Ce qui nous amène au titre « Tout va bien. Tout va bien aller maintenant »...
C.D. : Oui. Le titre est venu assez vite. Je crois qu’il est venu même avant que je finisse mon texte parce qu’il résume parfaitement la pièce. Les relations des personnages se résument à se dire que tout va bien pour se rassurer. C’est très révélateur du déni face au handicap : « mais non ça va aller, c’est juste un mauvais moment, il va s’en remettre ». Ce qui les empêche d’être face au réel. Ça va finir par aller car ils vont finir par l’accepter, mais pour l’instant ça ne va pas ni pour lui, ni pour nous, ni pour moi.
Une fois le texte fini et les travaux de recherche collective effectués, comment s’est fait le travail après l’écriture ?
C.D. : Plus j’écrivais, plus j’avais des images de plateau très précises qui s’animaient dans ma tête. Le texte en lui-même ne m’intéressait pas. Plus j’avançais, plus le texte sonnait. Donc je me rendais compte que c’était un texte qui avait besoin d’être activé au plateau, et qu’en lui même il n’avait pas grand intérêt. Il avait besoin de corps. Et puis au final je pense que c’était une histoire de rencontre : à un moment, j’ai rencontré des personnes avec qui j’avais envie de travailler. En fait c’est très confortable pour un premier projet de travailler avec un texte qu’on a écrit soi-même, car on peut le massacrer : la seule personne que l’on peut heurter, c’est soi-même. J’ai alors vraiment traité le texte comme un matériau que je pouvais déconstruire et réécrire. Et en travaillant avec le corps, on s’est rendu compte que certains passages de texte n’étaient plus nécessaires. Jusqu’à la dernière représentation, j’ai continué à réécrire et à retrancher.
Écrire ton propre texte sera donc un de tes critères pour tes prochains projets ?
C.D. : Pas forcément. Il y a beaucoup de textes que j’aime énormément, mais je ne me sens pas forcément capable de les mettre en scène. Et de toute façon, je crois que j’ai envie de moins de texte, en tout cas d’un texte moins imposant. Mais ce projet, même si on l’a travaillé de manière collective, au début je l’ai écrit moi-toute-seule-dans-ma-chambre, et je travaillais chaque répétition en amont moi-toute-seule-dans-ma-chambre, donc je pense que s’il y a un prochain projet ça sera plutôt un projet collectif.
As-tu justement des projets en tête ?
C.D. : C’est un peu la question en ce moment. J’ai pleins d’envies et de désirs. Mais j’ai vraiment besoin de temps pour me lancer dans un projet : des temps de réflexion, des temps d’écriture. Et je ne sais pas gérer deux projets à la fois. En tout cas, avec notre compagnie, on a envie d’aller au bout de ce spectacle et on sent qu’on a encore plein de choses à explorer. Chaque représentation et chaque répétition nous permettent de nous mettre en danger, de pousser chaque réflexion et chaque thème et de voir comment aller plus loin. Au-delà de ça, on adore travailler ensemble. Je pense qu’on a trouvé notre façon de le faire, on a réussi à créer notre univers et en même temps on arrive toujours à se surprendre entre nous. Cela a été un travail sans douleur, sans cri, sans pleurs, sans dispute.
On sent vraiment, en effet, que c’est un travail collectif qui a fait naître le projet. Comment chacun s’est-il investi puisqu’il y a à la fois des danseurs et des comédiens ?
C.D. : Au début, je n’ai pas voulu qu’ils lisent le texte. Je ne voulais pas qu’ils se fassent tout de suite une idée de ce qu’ils devaient renvoyer, je voulais qu’on ait un temps de recherche ensemble. J’ai préféré que les comédiens passent d’abord par un parcours sensoriel et corporel. On n’a travaillé que sur le corps pendant les deux premiers mois pour trouver une énergie commune. Cela passait par un travail d’improvisation, ou de recherche de matériaux. Par exemple, après leur travail sur le photographe et l’autoportrait, ils devaient en rendre compte aux autres par le corps. On a aussi fait des séances photos dans la rue. Je leur avais demandé de choisir un lieu qui les intéressait. On a donc fait beaucoup d’exercices et de recherche collective. Des fois cela servait simplement de méthode de travail. Mais quand on a vraiment commencé à jouer la pièce, on avait tout ce travail en tête.
Donc comment fait-on pour rentrer dans un personnage si on ne lit pas le texte avant ?
C.D. : Cela pouvait passer par des jeux, parfois très enfantins. On a cherché à travailler la question du contact. Qu’est ce que le toucher provoque chez nous ? Et on est passé par l’improvisation. Pour le personnage de Charlotte, les émotions et son mal être passent beaucoup par la peau : elle a de l’eczéma, elle se lave tout le temps, on a fait des exercice d’impro où elle se gratte. Comment le fait de se gratter peut-il évoluer ? Comment montrer cette envie incontrôlable ? Je donne juste un cadre, et les acteurs choisissent la manière dont ils veulent raconter les choses.
Comment as-tu relié écriture et images de corps ? Le langage corporel vient-il appuyer ou défaire le texte ?
C.D. : Je ne pense pas qu’il y ait une vraie coupure. Pour moi dans ce spectacle, le corps intervient quand la langue ne peut plus rien dire. Il y a certaines situations où on n’arrive pas ou plus à communiquer, où on perd nos moyens et nos mots ; c’est à ce moment là que le corps intervient. Et ce qui est génial avec la danse, c’est qu’en un seul geste, le corps peut exprimer ce qu’on aurait pu dire en une page. Par ailleurs il y a beaucoup de danseurs dans la compagnie, c’est leur premier moyen d’expression : parfois les acteurs butaient sur le texte, ça ne leur parlait pas, alors ils ont proposé de le dire avec le corps, ce qui était très intéressant.
Et donc si tu devais définir le genre du spectacle ?
C.D. : Ouh là ! (rires). Je pense que c’est avant tout du théâtre, même s’il y a énormément de danse. Je dirais du théâtre de corps.
As-tu effectué un travail différent avec ceux qui venaient de la danse et ceux qui étaient plutôt comédiens ?
C.D. : On a autant travaillé le corps avec les uns et les autres. Je pense que la technique chez un danseur ou chez un comédien donne une plus grande marge de liberté. Charlotte, qui est danseuse, a des moments très chorégraphiés, contrairement à Théo, qui est comédien, et pour lequel la maîtrise du corps est moins évidente. Mais dans notre spectacle la question « est-ce que ce geste est bien fait ou pas ? » ne s’est pas posée. Peu importe la technique des gestes : ce qui nous importe réellement, c’est d’être, chacun dans notre domaine, au maximum de notre capacité.